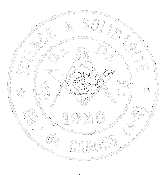Conférence pour le Cercle Condorcet du mardi 12 janvier 2010
Propos introductifs sur le sens de ce travail.
Il ne s’agit pas de fournir, du moins directement, une énième contribution au débat en cours qui, d’ailleurs, va se poursuivre, mais de tenter d’apporter quelque lumières sur les termes du débat sans négliger le débat sur les termes employés, en faisant référence à l’histoire de notre pays et à quelques acquis solides des sciences sociales, de l’histoire et de la philosophie politique. Essayer, dans la mesure du possible, d’éclairer votre jugement sans le contraindre, ce qui sera une tâche difficile. Mais, ici, je n’exprime pas le point de vue du Cercle Condorcet ou de la Ligue de l’Enseignement, mais le résultat d’un travail de connaissance et de réflexion personnel sur le sujet, ce qui signifiera que s’exprimeront aussi des jugements de valeur sur cette question de l’identité nationale, inévitables dans cette période… Chacun d’entre nous, en tant que citoyen, a une opinion sur le thème de l’identité nationale et sur le débat en cours en France initié par le gouvernement, sur sa signification, ses avantages et ses inconvénients, sur ses motivations et sur ses effets. Les réflexions proposées ici permettent de définir cette notion, d’en cerner les contours, d’en fixer les contenus, d’en montrer les représentations dans le champ politique, d’en poser les jalons historiques et d’essayer d’en comprendre les enjeux ce qui, vous en conviendrez, est déjà considérable !
Ce sera ainsi une manière d’être dans ce débat sans y être, du moins dans sa dimension immédiatement polémique, ce que permet la référence à l’histoire ; ou, si vous préférez, partir du débat actuel sur l’identité nationale pour montrer comment cette question (ou ce « problème ») a progressivement émergé depuis les années 1870 (permettre de relier l’étude du présent à celle du passé – G. Noiriel). Comme toujours, la discussion sera totalement ouverte. Évidemment, en plaçant cette intervention sous l’égide du Cercle Condorcet et de la Ligue de l’Enseignement, nous affirmons une filiation républicaine, démocratique et laïque, pluraliste et tolérante. Si nous faisons référence à Condorcet, philosophe des Lumières, homme politique de la Révolution de 1789 et constitutionnaliste, penseur du libéralisme philosophique et politique, c’est parce qu’il a su combiner travail intellectuel et engagement civique, humanisme et raison, réflexion personnelle et collégialité de la discussion, rigueur scientifique et honnêteté, et donner un sens aux idéaux de progrès et de perfectibilité, sans jamais renier ses convictions ni faire preuve d’opportunisme, avec une pratique permanente du débat citoyen et de la proposition.
INTRODUCTION.
Doit-on dire avec Montesquieu que : « Je suis nécessairement homme et je ne suis français que par hasard » ? Mais je deviens homme en participant à la société nationale où ce hasard m’a fait naître, et je construis ma propre identité sous l’influence des identités collectives qui constituent le cadre référentiel de ma socialisation et qui se cristallisent plus ou moins en moi. Nous intériorisons tous au fond de nous cette « identité nationale » supplémentairement aux autres identités des milieux où nous vivons et auxquels nous appartenons ou auxquels nous voulons nous identifier en prenant de la distance avec nos appartenances premières (famille, catégorie sociale, religion, culture régionale, etc.). Mais déjà se pose un problème : comment l’identification à cet « objet » qu’est l’identité nationale s’opère-t-elle en chacun de nous, comment la vivons-nous, comment l’appréhendons-nous, quels sens lui donnons-nous dans le processus de construction de notre propre identité individuelle car chacun d’entre nous est un sujet ouvert sur un environnement non clos et relativement mouvant et qui se construit dans cette relation individu/collectivités (au pluriel) d’appartenance.
Des polémiques ont été amenées par l’importance de ce thème dans la dernière campagne présidentielle, le débat actuel lancé par le gouvernement qui renoue, d’ailleurs, avec une habitude bien française depuis la Révolution (cf. controverse sur les origines du peuple français opposant les partisans des Gaulois-les révolutionnaires- à ceux des Francs – la noblesse) et par la création d’un ministère associant notamment « immigration » et « identité nationale », à des fins de « marqueur » vis-à-vis de l’opinion publique. Cette actualisation qui, pour un anthropologue (R. Meyran) est loin d’être anodine et « consacre, en l’institutionnalisant », le « retour du grand mythe de l’identité nationale » (page 178), ou pour reprendre l’expression d’un anthropologue (M. Detienne), une « mythidéologie » (une « configuration complexe de représentations, d’images et d’idées ») dont l’Europe contemporaine est riche (cf. la difficile formation des Etats-nations en Europe de l’est après l’effondrement de l’U.R.S.S.). Et d’ajouter (R. Meyran) que la réactivation de ce mythe est porteuse « d’effets bien réels » (P. Bourdieu) et immédiats en présentant, explicitement chez les uns ou implicitement chez les autres, la figure de l’Autre, c’est-à-dire l’étranger ou l’immigré, ou du moins un certain type d’immigré, comme un « problème » ou comme une « menace » pour l’identité nationale. Cette problématique n’est pas nouvelle dans l’histoire mouvementée de la France ; elle s’est violemment exprimée au moment de l’affaire Dreyfus et a atteint son paroxysme dans l’ultranationalisme des années 1930 et sous le régime de Vichy où deux grands items étaient mobilisés au sujet de l’identité nationale : la notion de « race » et la notion de « culture ». Donc, cette question est plus ou moins récurrente dans notre pays ; elle émerge très explicitement au XIXème siècle, particulièrement à partir des années 1870-1880, lorsque se construit la République ; au cours de cette période s’affrontent avec violence deux conceptions rivales de la France et, donc, de l’identité nationale : celle, en formation, de l’identité républicaine, jacobine, laïque et patriote, qui veut achever l’œuvre de la Révolution, et celle de la droite antidreyfusarde, catholique, et ultranationaliste, souvent monarchiste, inspirée de la pensée contre-révolutionnaire ( les « Anti-Lumières ») d’un Xavier de Maistre et théorisée par Maurice Barrès puis Charles Maurras (cf. P. Birnbaum : « La France imaginée »). Cette confrontation des identités politiques, depuis, traverse la société et la vie politique françaises de façon cyclique, avec une succession de périodes de marée montante et d’exacerbation, puis de décrue et de mise en sourdine. La sociologue Dominique Schnapper pointe ici un domaine de l’exceptionnalité française (dans « La communauté des citoyens » page 67), en écrivant qu’« on peut se demander si cette interrogation collective et conflictuelle sur l’identité et le sens de la nation, qui a parcouru l’histoire politique depuis la Révolution, n’a pas eu aussi, de manière paradoxale, une certaine fonction d’intégration, dans la mesure où les uns et les autres invoquaient la « vraie » France , prétendaient, seuls, incarner la vraie nation française et en appelaient à un patriotisme également ardent ». Ce qui lui fait dire que « la France a été sans doute la plus politique des nations européennes » (dans « La France de l’intégration ») et qu’il y a bien une « manière française de faire de la politique » (revue Sciences Humaines, op. cit.). L’expression « identité nationale » est récente ; on parlait plutôt, avec Ernest Renan notamment (cf. sa conférence de 1882), d’ « âme » de la nation, de « caractère national » ou de « personnalité » d’une nation comme s’il s’agissait d’un être humain (en particulier chez Michelet dans le contexte du XIXème siècle pour lequel la France est une « personne ») ; ce qui n’est pas toutefois sans portée idéologique ; une « âme » serait intemporelle, une espèce d’essence qui traverserait le temps, et vers laquelle il faudrait se tourner, voire retourner, car elle fournit des racines et donne du sens à l’appartenance nationale ; c’est le catéchisme républicain de l’histoire écrit par Ernest Lavisse et enseigné à partir de 1884 qui fait quasiment de la France un « être incréé » (Suzanne Citron) : « notre pays existe depuis toujours » y lisait-on. Cette approche essentialiste et, disons-le, anachronique, est récusée de nos jours par les sciences sociales et la philosophie politique, au profit d’une approche complexe en termes de « construction » et de pluralité des identités, ce qui est conforme aux enseignements de l’histoire comme nous le verrons plus loin. Peut-on « être Français » en 2010 comme on l’était en 1789 ou en 1871 ? A quelles représentations renvoie l’idée d’une « France éternelle » chez certains ? Le maniement des symboles historiques (évènements, dates, personnages) n’est jamais anecdotique ni anodin dans la bouche ou sous la plume des hommes politiques, comme les figures de rhétorique et le vocabulaire employés ; le grand anthropologue Georges Balandier dit que « les mots de pouvoir ne circulent pas à la manière des autres » (dans « Le pouvoir sur scène ».Balland. 1980, page 32). (cf. « Les mots de Nicolas Sarkozy », de Jean-Louis Calvet et Jean Veronis). La compétition pour le pouvoir, dans les élections récentes en France, le montre clairement ; des travaux ont montré le langage utilisée par les candidats, la représentation qu’il fournisse de la nation, la volonté de « réinventer le national » (N. Offenstadt) pour donner du « sens » au projet politique proposé, la mobilisation des références historiques dans une approche narrative et quelque peu étonnante de la société, de ses transformations et de sa proclamée « crise d’identité ». Ajoutons aussi que la « démocratie d’opinion » et « l’information-spectacle » recourant aux techniques du marketing politique ne contribuent pas toujours positivement à rendre le débat plus clair.
L’usage scientifique de l’expression « identité » se trouve initialement dans les travaux relevant de la psychanalyse et de la psychologie avec le psychanalyste Erik Erikson (identité, identification) ; au cours des années 1950 des intellectuels progressistes américains utilisent l’expression « national identity » pour promouvoir l’intégration des immigrants dans le « creuset américain » face à une droite qui les rejette (comme le mentionne G. Noiriel). Depuis son emploi investit les champs de la sociologie, de l’anthropologie culturelle, de l’histoire, de la science politique et de la philosophie politique. En même temps, cette expression est mobilisée dans le débat politique de façon souvent polémique, car des intérêts, des mécanismes de pouvoir, d’hégémonie idéologique, des représentations de ce qu’est l’identité de la France, y sont en jeu et définissent des enjeux. Les historiens soulignent que la formation d’une identité nationale est « une construction militante, associée à un projet politique » (Anne-Marie Thiesse, dans « Le Monde diplomatique » de juin 1999) ce qui laisse déjà deviner les confrontations auxquelles la définition et l’affirmation des conceptions de l’identité nationale ont donné lieu. Or, nous avons deux mondes qui s’ignorent relativement : d’un côté, la communauté des chercheurs en sciences sociales qui produit des connaissances et des problématiques, soumises à la discussion critique, depuis fort longtemps, sur ce sujet, et de l’autre, des décideurs politiques qui ignorent ou mobilisent sélectivement ces travaux patients et peu médiatisés et qui « bricolent » des pseudo-vérités historiques projetées sans fard dans le débat public, construisent fréquemment des matrices historiques à leur convenance qui risquent de ne plus laisser beaucoup de place pour la réflexion critique et le débat démocratique par leur caractère parfois incantatoire et impératif et qui sont au service de leurs stratégies politiques de conquête et de conservation du pouvoir. Non, les idéologies ne sont pas mortes ! Fort heureusement, d’ailleurs, car elles suscitent confrontations et débats…
Aussi, étudier l’identité nationale implique d’aborder trois dimensions qui seront souvent traitées de façon articulée : l’identité nationale est une notion, nous n’osons pas dire un « concept », qui n’est pas souvent définie ou qu’il est difficile de définir, mais elle est aussi une expression mobilisée dans le discours politique de façon malléable et flexible selon les usages que l’on en fait et les intentions qui animent ce discours – or, l’approche sémantique est capitale pour savoir de quoi l’on parle ; il faut définir les termes employés dans le débat, tout en soulignant qu’il y a aussi débat sur les termes employés (identité nationale, identité française, identité républicaine, identité démocratique, voire refus de l’expression « identité nationale ») ; elle a une histoire; elle est un « fait historique indiscutable » car les acteurs de la vie sociale et politique agissent en son nom (P.A. Taguieff (revue « Mots » n° 12 (1), elle s’exprime à travers différents registres (la culture, la politique, les valeurs, la conscience collective, la mémoire historique), et elle est un système de références collectif jamais définitif ; à ce titre, il faut faire référence à sa construction, à ses mutations et aux représentations souvent conflictuelles qu’elle véhicule ; et elle est un enjeu ou source d’enjeux, et, dans ce cadre, elle renvoie, tant au niveau de son élaboration historique qu’à celui de sa mobilisation dans le discours, à des questions de pouvoir, d’hégémonie, d’influence, de luttes, d’idéologie et de reconnaissance, avec, en filigrane, cette question souvent posée : « Qu’est-ce qu’être Français ? » ou « Comment peut-on être Français » (titre du livre d’un conseiller du Président de la République, Rachid Kaci). Aussi, simultanément, la définition de l’identité nationale implique une réflexion sur la « nation », au sens moderne du terme, corps politique issu des grands bouleversements politiques du XVIIème au XIXème siècle, et, là encore, les enjeux à la fois théoriques et concrets, idéologiques et politiques, sont souvent conflictuels. Comme le souligne Dominique Schnapper « la nation reste une dimension privilégiée de l’identité collective où s’exprime la continuité de la mémoire historique » et demeure aussi, encore de nos jours, « le lieu de l’expression et des pratiques démocratiques », même si l’on évoque l’émergence d’une identité post-nationale – avec la construction européenne notamment (revue Sciences humaines, hors série n° 10. 1995).
L’historien Fernand Braudel posait la question : « L’identité française relève-t-elle de nos fantasmes collectifs ? Il y a des fantasmes et il y a autre chose (…). Quels que soient nos fantasmes, il y a une réalité sous-subjacente de la culture, de la politique de la société française » (dans un article du journal « Le Monde » (24-25 mars 1985). Pour Braudel, il fallait rechercher l’identité française en dehors de toute position partisane et il était contre l’attitude visant à « construire l’identité française au gré des fantasmes (et) des opinions politiques ». Et, si l’on accepte cette réalité de l’identité nationale, quelle que soit la définition que l’on en donne, que signifierait alors l’idée d’une « crise » de cette identité ? Est-elle elle-même pertinente ? Ce peut faire l’objet d’une discussion.
Nous déroulerons notre démarche de la façon suivante : tout d’abord, définir l’identité nationale, ses caractéristiques, son contenu et ses fonctions, puis mettre en perspective historique les conceptions de la nation et de l’identité nationale en France, en insistant sur la narration de cette identité par les acteurs de la vie politique.
1- Le sens de l’expression « identité nationale » et son contenu.
La notion même d’identité nationale semble soulever plus de questions que de certitudes, d’autant plus qu’elle relève fréquemment de l’ordre du discours politique qui n’est jamais idéologiquement neutre dans l’espace public et que ce discours n’est pas reçu et perçu de façon identique selon les référents de l’auditeur (philosophiques, religieux, politiques, culturels), selon la force de ses appartenances personnelles ou de ses vides identitaires, de son degré d’ouverture au monde et de son degré d’intégration sociale. Comme le souligne l’historien Gérard Noiriel qui préside le « Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire », « les ambiguïtés sémantiques du terme favorisent les entreprises de manipulation politique auxquelles, en France, le problème de « l’identité nationale » a constamment donné lieu » (dans « Etat, nation et immigration » page 247). Nous allons nous rendre compte de la difficulté à cerner cette notion, alors qu’elle est si couramment employée en ce moment.
A -Commençons donc par une réflexion sur la notion d’« identité nationale ».
L’identité relève d’une problématique universelle, par delà le temps et l’espace ; qu’elle soit vécue consciemment ou implicite, elle façonne les attitudes, elle constitue le substrat, non immuable, des comportements car elle se construit et se reconstruit.
L’identité, au sens premier du terme, c’est ce qui est identique (unité) mais aussi, son contraire, dans la relation avec un autre objet, ce qui est distinct (unicité). L’identité est donc d’emblée similitude, source de cohésion entre les composantes d’un même ensemble, et différence, source de singularité, de distinction et d’affirmation quand ce n’est pas d’opposition, entre cet ensemble et les autres ensembles. Au cœur de la définition, se trouvent mis en relation le « le Même » et « l’Autre ». C’est dans la relation à l’Autre que se construit cette « Mêmeté », de ce qui est proclamé comme semblable et commun. L’identité est, de ce fait, relation et non essence immuable, car elle est le résultat d’un processus dynamique de définition et de redéfinition dans la relation avec d’autres identités et sous l’influence de puissants facteurs internes et externes de transformation (que nous évoquerons plus loin).
Trois niveaux sont appréhendés dans l’étude de l’identité : individu, groupes, nation. L’identité concerne les individus (elle se construit progressivement au cours de leur existence, avec l’étape décisive de la petite enfance, dans la relation avec les autres ; elle est à la fois « une et multiple de par le nombre de rapports qu’on entretient avec les autres » (Maurice Godelier) (familiaux, professionnels, culturels, politiques, religieux, etc.) ; l’identité nationale est une composante dans la construction identitaire de l’individu. L’évoquer, c’est aussi penser, au niveau des individus, la revendication à être différent des identités reçues ou imposées et d’affirmer ainsi sa liberté à l’égard des déterminismes des appartenances assignées par la naissance, le statut social ou le cadre national (mais ce n’est pas directement le thème de cet exposé). ). La liberté du sujet est en cause quand on prétend conférer une transcendance de type absolutiste à l’identité nationale ou à une identité collective particulière ; en effet, « vouloir enfermer l’individu dans son groupe d’origine est illégitime, car cela revient à nier cette caractéristique précieuse de l’espèce humaine, la possibilité de s’arracher au donné pour lui préférer ce qu’on a soi-même choisi » (T.Todorov : « La peur des barbares » page 99). Aussi, la liberté de conscience, au centre de la laïcité, est un contrepoids au culte de l’identité ; d’autres ont dit : « avoir le droit d’être différent de sa propre différence », soit s’arracher aux identités acquises pour construire librement sa propre identité sans référence aux « marqueurs identitaires » – ethnoculturels, religieux- et à « l’enfermement » que la soumission à l’identité du groupe peut provoquer et que les intégristes de tous poils encouragent ou imposent, inquiets de la liberté individuelle et des choix fondés sur la raison du sujet – rappelons ici le « principe de laïcité » comme fondement du « vivre-ensemble » et le refus du « communautarisme » en tant que dispositifs institutionnalisés permettant, dans certains domaines, d’échapper à la loi commune et d’exercer une emprise de groupe sur l’individu. Les enquêtes menées en France (octobre 2005-avril 2007) (cf. Hervé Marchal dans « Immigration et identité nationale. Une altérité revisitée ». pages 202-203) montrent, contrairement aux affirmations de certains discours politiques, que « l’identité nationale n’est pas un support central et omniprésent dans les esprits » et que « le fait d’être français s’avère important ou non selon les situations » ; la logique serait plutôt celle d’une « logique de mobilisation identitaire « à la carte », l’identité nationale n’étant qu’une carte parmi d’autres dans le jeu identitaire de chacun » (avec les cartes de la profession, de la famille, du quartier, de la ville, de la région, de l’Europe, du monde…) ce qu’Edgar Morin appelle une « poly-identité » ; l’identité concerne les groupes, politiques, sociaux et philosophiques (identité politique des partis, identité religieuse, identité spirituelle, identité professionnelle, identité régionale, identité culturelle – arts plastiques, musique, courants littéraires…) – dans ces deux cas (individu, groupe) l’identité nationale est une « identité latente » que les individus ou les acteurs sociaux et politiques mobilisent « dans certains contextes, mais qu’ils tiennent à distance tant que leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu » (G. Noiriel) , et qu’ils activent et réactivent à des fins idéologiques ou politiques par exemple, lors d’élections, lors de crises politiques ou économiques, lors des périodes de remodelage du rapport des individus à la nation – comme avec la mondialisation contemporaine, l’intégration européenne, ou avec les questions soulevées par l’intégration des populations immigrées depuis le milieu du XIXème siècle ; et la nation qui nous intéresse ici et que nous développerons un peu plus loin. L’identité peut même dépasser le cadre national avec, par exemple, une identité commune façonnée par l’histoire ou en construction entre les nations de l’Europe ou une identité religieuse. Le philosophe Paul Ricœur (dans « Soi-même comme un autre ». Seuil. 1990) a proposé deux termes au sujet de toute identité qui permettent aussi de caractériser l’identité nationale, comme le suggère Gérard Noiriel (dans « A quoi sert l’identité « nationale ») et en exprime les deux facettes : le « semblable » désigné sous le terme de « mêmeté » (latin « idem », anglais « sameness »), et le « propre » désigné comme « ipséité » (latin « ipse », anglais « selfhood ») :
l’identité comme « mêmeté » qui fait reposer cette identité sur la présence de
caractéristiques communes aux membres d’une collectivité nationale par rapport aux autres nations et qui fait que toute « identité nationale » est plus ou moins unique et originale, par opposition aux autres identités – mais première interrogation : quels sont ces traits fondamentaux, ces éléments qui sont au cœur de l’identité nationale ? Sélection, hiérarchisation, omission, refoulement, voire erreurs, peuvent être au centre du processus de construction de l’identité nationale et/ou de sa mobilisation dans le discours politique ou dans sa narration historique ; toute identité se construit dans la relation avec l’Autre, souvent dans des processus d’affrontements (ex : guerres), et potentiellement ou réellement, elle articule inclusion et exclusion ; elle s’élabore dans des interactions au cours de l’histoire qui lui ôtent donc tout caractère de fixité et d’immutabilité, ce qui ne signifie pas la permanence de certaines dimensions, objectives ou symboliques, lentement façonnées ; citons Fernand Braudel : « Qu’entend-on par identité de la France (…) sinon le résultat vivant de ce que l’interminable passé a déposé patiemment par couches successives, comme le dépôt imperceptible de sédiments marins a créé, à force de durer, les puissantes assises de la croûte terrestre ? En somme un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges. Un processus, un combat contre soi-même, destiné à se perpétuer. S’il s’interrompait, tout s’écroulerait. Une nation ne peut être qu’au prix de se chercher elle-même sans fin, de se transformer dans le sens de son évolution logique, de s’opposer à autrui sans défaillance, de s’identifier au meilleur, à l’essentiel de soi ». De plus, dans la définition des éléments qui composent l’identité nationale et qui convoquent le sentiment national, se sont affrontées des conceptions concurrentes sous la IIIème République et encore de nos jours ; « définir l’identité nationale est un enjeu vital » (G. Noiriel) car elle renvoie à un certain rapport au passé, à un vivre-ensemble présent et à un projet d’avenir, comme l’évoquait Ernest Renan, et aux instances qui remplissent une fonction d’intégration au sein de la nation (citoyenneté, École, service militaire autrefois).
L’identité comme « ipséité » (du latin « ipse » : « soi », « lui-même », « en personne ») ou identité du soi qui désigne la conscience de soi impliquant la continuité dans le temps, s’exprimant à travers une mémoire collective, des rites, des cérémonies, des commémorations, des rassemblements, des engagements, un enseignement de l’histoire – question capitale comme nous le verrons plus loin-, etc. ; mais ceci ne signifie pas que l’identité soit figée, close et fossilisée et que la mémoire ne soit pas le lieu d’affrontements, de redéfinitions profondes ou la marge, et d’interprétations divergentes… L’identité nationale est plus ou moins présente en chacun de nous comme sentiment d’appartenance à un groupe national et élément de la conscience collective (un « nous français » et un « Nous, français ») ; elle est intériorisée sous forme d’« habitus », pour reprendre une notion sociologique. Elle dépasse les identités des groupes qui composent la nation et contribuent à cimenter l’adhésion des individus à la collectivité nationale à travers le temps, même si cette adhésion peut exprimer, au-delà de l’objectivité de ses fondements (langue, histoire, patrimoine, principes et valeurs…), des interprétations différentes, des mises à distance critiques ou des nostalgies (d’un hypothétique « âge d’or » de la nation, de ses racines, etc.). Toute identité nationale est à la fois une et plurielle, elle ne se décrète pas d’en haut, elle ne peut être une injonction ou une « imposition idéologique » (V. Duclert : « La France. Une identité démocratique »), sauf dans les régimes totalitaires ou populistes, ce qui n’exclut pas que le pouvoir politique n’ait pas sa part dans le débat, car, dans une démocratie, le pluralisme des idées et des représentations est un vecteur du débat citoyen, quelque conflictuel qu’il soit. Mais, bien sûr, il faut s’interroger sur les finalités, les conditions et les procédures mises en œuvre dans un débat national, sur la mobilisation du passé par le pouvoir politique, sur ses intentions et sa méthode d’exposition de ce passé à des fins actuelles…D’autant plus, que la narration, de nos jours, peut relever plus des lois de la politique-spectacle, du marketing politique, du registre de l’émotion, et d’une « machine à fabriquer des histoires » que de la démarche histoire scientifique, et que les hommes politiques mettent aussi en scène leur propre histoire à travers ce récit ou les chemins de la construction de leur propre identité personnelle ou y projettent leur conception du monde quand ce n’est pas leurs fantasmes… Cette technique qui a envahi tout l’espace de la vie politique lors de la dernière élection présidentielle, pratiquée par les deux principaux candidats, et qui continue d’être mise en œuvre, vient des Etats-Unis et elle est connue sous le nom de « Storytelling », soit « l’art de raconter des histoires » (Christian Salmon : « Storytelling – la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits ». La Découverte/Poche). Permettez-moi de citer le conseiller du Président de la République qui rédige ou inspire ses discours : « La politique, c’est écrire une histoire partagée par ceux qui la font et ceux à qui elle est destinée. On ne transforme pas un pays sans être capable d’écrire et de raconter une histoire » (« Le Monde » en juillet 2007). La candidate du second tour disait, quant à elle, que « faire de la politique, c’est raconter des histoires dont les citoyens sont les acteurs ». Mais quelle histoire ou plutôt quelle narration ? Nous sommes là au cœur de la définition de l’identité nationale comme nous serons amenés à le voir en raison de la mobilisation des références historiques. Ajoutons cette réflexion de l’historien Lucien Febvre : « Une histoire qui sert est une histoire serve ».
Insistons sur quelques points essentiels dans l’étude de la notion d’identité nationale.
Point central à souligner : la problématique aujourd’hui consensuelle dans la communauté des chercheurs est que « les identités nationales ne sont pas des faits de nature mais des constructions », de véritables « fabrications culturelles », principalement élaborées au cours des XVIIIème et XIXème siècles dans divers pays d’Europe ; elles ont été, rappelons-le, des constructions militantes associées à un projet politique fondateur, celui de la nation politique, conçue comme une « communauté de citoyens », égaux en droits et dont la légitimité politique est fondée sur la volonté des peuples, source de la souveraineté nationale, et non sur la soumission à un principe dynastique ou religieux – point que nous expliciterons bientôt (comme l’exprime Anne-Marie Thiesse – auteure d’un ouvrage fondamental sur le sujet : « La création des identités nationales. Europe XVIIIè-XXè siècles ». Points-Seuil. Histoire). Les études de politique comparée menée par Jean-François Bayart (cf. « L’illusion identitaire ») montre que « dans les faits, chacune de ces « identités » est au mieux une construction culturelle, une construction politique ou idéologique, c’est-à-dire, in fine, une construction historique. Il n’y a pas d’identité naturelle qui s’imposerait à nous par la force des choses (..). Il n’y a que des stratégies identitaires, rationnellement conduites par des acteurs identifiables » (et, ajoute-t-il, « des rêves ou cauchemars identitaires auxquels nous adhérons parce qu’ils nous enchantent ou nous terrorisent » (page 10). L’auteur fait référence, notamment, aux nationalismes de l’entre-deux guerres, aux problèmes des Balkans depuis la dislocation de l’espace soviétique, aux violences politico-ethniques dans le monde).
Les travaux d’histoire des nations ont montré qu’en Europe, du XVIIIème au XXème siècle, l’identité nationale, liée à l’émergence des Etats-nations ou des nations modernes, a obéi aux mêmes processus de construction culturelle et symbolique et de légitimation historique ; comme l’explique Anne-Marie Thiesse, le paradoxe est que chaque identité est irréductible à l’autre et a été le prétexte de violents affrontements, tout en étant issue du même modèle (des mêmes « moules », des formes identiques) dont la réalisation s’est accomplie « dans le cadre d’intenses échanges internationaux ». En effet, dit-elle, « la véritable naissance d’une nation, c’est le moment privilégié où une poignée d’individus déclare qu’elle existe et entreprend de le prouver ». Les premiers exemples de ce moment n’existent pas avant le XVIIIème siècle : « pas de nation au sens moderne, c’est-à-dire politique, avant cette date » : c’est-à-dire une communauté de citoyens fondée sur la souveraineté du peuple et l’égalité des droits, « communauté dont l’existence légitime l’action intérieure et l’action extérieure de l’Etat » comme l’exprime Dominique Schnapper (dans « La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation ». Nrf essais. Gallimard), et non sur la sujétion à un monarque ou l’appartenance à une même religion, même si ces éléments contribuent à l’identité nationale
dans sa généalogie historique. On a appris à établir la liste identitaire des éléments culturels, matériels et symboliques qui sont le patrimoine et l’héritage d’une nation et du sentiment national, une sorte de « check-list » dont le contenu, au-delà des formes communes, varie sensiblement selon les sociétés nationales : « une histoire établissant la continuité avec les grands ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des représentations officielles –hymne et drapeau-, des identifications pittoresques – costume, spécialités culinaires ou animal emblématique » (A. M. Thiesse, page 14). Au XIXème siècle, un long et considérable travail d’élaboration, de mise à jour, de ré-interprétation et de codification de tous ces éléments a été réalisé, dans les pays d’Europe dont le travail d’A.M. Thiesse met à jour le contenu et les processus : « tout le processus de formation identitaire a consisté à déterminer le patrimoine de chaque nation et à en diffuser le culte sous l’égide du pouvoir politique, notamment à travers l’Ecole » ; cette « fabrication collective des identités nationales » a obéi à une démarche similaire et souvent coordonnée en Europe : intellectuels et lettrés anglais, écossais, allemands, français, hongrois, italiens, tchèques, danois, russes, etc., ont procédé de la même façon : exhumation et souvent réécriture de textes anciens, confection de grandes sagas nationales mobilisant des héros réels ou mythiques (des « Odyssées » nationales), redécouverte et restauration du patrimoine archéologique (cf. Viollet-Leduc en France), hauts lieux historiques, commémorations d’évènements historiques, pièces de théâtres, romans à vocation historique, musiques à travers l’opéra et la collecte des mélodies populaires, collecte de contes et poésies populaires, mise en valeur d’un folklore, production des emblèmes de la nation (le drapeau, l’hymne), peintures historiques, expositions nationales, création de musées nationaux, création d’une langue nationale quand elle n’existait pas en raison de la domination d’une langue étrangère ou de la juxtaposition de langues locales spécifiques… Ce travail de construction sera mobilisé politiquement pour affirmer l’identité nationale face à celle des autres. La liste des éléments matériels et symboliques qui constituent l’infrastructure de l’identité nationale s’est opérée partout en Europe du XVIIIème et au XXème siècle et encore aujourd’hui avec l’apparition de nouveaux pays indépendants en Europe de l’Est et dans le monde depuis le début de la décolonisation.
Mais l’identité nationale, dans sa dimension plus politique, est aussi faite de la mémoire des combats, des ruptures et des conflits majeurs et aussi des mutations centrales qui ont façonné la société et son rapport avec l’extérieur (révolution, guerres, résistance à un envahisseur, colonisation, intégration dans un cadre politique plus large comme l’Europe ), mais aussi dans sa construction intérieure (grands enjeux civiques et politiques comme la séparation de l’Eglise et de l’Etat en France et l’organisation des institutions politiques, guerre civile, persécutions religieuses et politiques, etc.).
Les identités nationales ne sont pas des objets stables et facilement reconnus ; étant des constructions, elles sont refaçonnées par les contacts dans la société politique internationale, par les défis auxquels doivent répondre les sociétés et les cultures nationales, par l’intensification des échanges de tous ordres – économiques, technologiques, culturels, informationnels- , par les mouvements de population à l’échelle des pays, des continents ou du globe, par les leçons tirées des conflits, des guerres et des excès nationalistes au cours desquels l’identité de chaque nation s’affirme contre celles des autres, par les progrès de la démocratie, par l’essor d’une culture de masse consommatrice d’objets symboliques, et par le pouvoir politique comme nous le verrons à propos de la France sous la IIIème République, etc.. Le sentiment d’une « crise de l’identité nationale » peut provenir de l’impact de ces mutations qui rendent plus floue, moins explicite, sa définition et son vécu. L’approche constructiviste (l’identité est le résultat…) s’oppose à une conception essentialiste qui ferait de l’identité un « déjà-là » intangible, une permanence, un substrat quasiment figé, un donné immuable. C’est là tout le problème d’un discours qui fait ou risque de faire apparaître l’identité nationale « comme quelque chose d’extérieur à soi, comme réifiée » et qui n’est pas pensée comme un produit de l’activité humaine, c’est-à-dire un discours qui réduit de façon arbitraire et statique l’identité nationale à un état de chose ou d’objet (Fred Constant : « Le multiculturalisme ») ; et c’est à cette « chose » que l’on demanderait d’adhérer.
Deuxième point à souligner : Les identités nationales relèvent aussi d’un « imaginaire collectif » qu’elles produisent, car la nation est un « lieu symbolique d’identification collective » (D. Schnapper) pour ses membres, au-delà de leurs appartenances particulières.
Benedict Anderson qualifie les nations de « communautés imaginées » pour parler de ce sentiment national qui fait que des individus tendent à s’identifier à d’autres, parfois « corps et âme », sans relation de proximité physique immédiate et sans les connaître. Nous nous poserons la question, plus particulièrement à propos de la France, formulée par cet auteur : « pourquoi les nations, si manifestement nouvelles, se sont-elles imaginées anciennes dès le premier quart du XIXème siècle » ? Cet imaginaire collectif s’exprime dans des symboles d’appartenance à la nation et est entretenu, comme cela a été décrit précédemment, par des commémorations, des musées, des références parfois quasi-mythiques, des emblèmes de la nation, des œuvres littéraires et artistiques, une façon de raconter son histoire, et il est véhiculé par un « roman national » a-t-on pu écrire au sujet de la France, car cette communauté nationale fait l’objet d’une narration. Paul Ricoeur soulignait que l’identité est une « identité narrative », qui permet « à des citoyens aux passés différents de se retrouver en elle » (Patrick Weil : « La République et sa diversité » page 106) et, comme l’écrivait Fernand Braudel au sujet de la nation, « conséquemment de se reconnaître au vu d’images de marque, de mots de passe connus des initiés (que ceux-ci soient une élite ou la masse entière, ce qui n’est pas toujours le cas). Se reconnaître à mille tests, croyances, discours, alibis, vaste inconscient sans rivages, obscures confluences, idéologie, mythes, fantasmes ». Cette identité narrative est un enjeu car, comme le souligne encore Georges Balandier (op. cit. page 17) le passé « est une réserve d’images, de symboles, de modèles d’action ; il permet d’employer une histoire idéalisée, construite et reconstruite selon les nécessités, au service du pouvoir présent. Ce dernier gère, en assure ses privilèges, par la mise en scène d’un héritage ».Cette narration est productrice de sens et de symboles. Or, dans le cas de la France, l’Etat ayant joué un rôle central dans la construction de la nation (on a pu parler d’un « instituteur du social »), il a été et il est toujours « l’instrument et l’expression privilégiés de la réalité et de l’identité nationale » (D. Schnapper dans « La France de l’intégration »). Le tri sélectif et l’oubli aussi sont constitutifs de l’opération de construction et de reconstruction de la mémoire collective, Ernest Renan le soulignait déjà dans son livre : « Qu’est-ce qu’une nation ? » : « l’oubli, je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de création de la nation ». Mais, face à l’emprise des identités collectives, dans la modernité du dernier demi-siècle, l’individu « se donne le droit d’élire son héritage », d’opérer une sélection parmi les éléments ou les versions de l’identité nationale, car l’identité est plus fluide et multidimensionnelle ; ce qui fait dire à un sociologue (F. de Singly dans « Les uns avec les autres » page 33) « qu’il s’agit d’une inversion de la relation d’héritage. L’héritier écrit le testament » ; cela rejoint la réflexion d’un acteur et penseur de la révolution américaine, Thomas Paine, ami de Condorcet, qui écrivait : « Je défends les droits des vivants et je m’efforce d’empêcher qu’ils soient aliénés, altérés ou diminués par l’autorité usurpée des morts » (dans « Les droits de l’homme »).Voici un des domaines qui caractérisent les rapports diversifiés des individus à l’identité nationale. Mais un des problèmes majeurs pour cette narration et ce récit national en France, c’est qu’ils ont occulté ou refoulé fréquemment depuis plus d’un siècle des pans entiers constitutifs de son histoire (l’immigration, la colonisation, l’esclavage et la traite négrière) qui ressurgissent à travers des mémoires plurielles, alors qu’ils font partie intégrante de la construction de son identité nationale , comme de nombreux travaux d’historiens le montrent aujourd’hui (cf. les ouvrages de N. Bancel, P. Blanchard, S. Citron cités en bibliographie) : conception de la « République coloniale », relation à l’Autre et stéréotypes, mission civilisatrice de la France et supériorité du modèle français, à la différence de l’Angleterre représentée comme un Empire de pure exploitation, imaginaire colonial (cf. expositions, littérature, films, vocabulaire), sources de l’immigration, racialisation de l’identité nationale (très en vogue dans les années 1930), images et représentations du Noir, de l’Arabe, de l’exotisme et de la sexualité, racisme et discriminations, relations politiques avec l’Afrique … Ces processus ont marqué les consciences des Français et ont participé à la fabrication de l’identité nationale. Dans certaines représentations, débouchant sur des propagandes très actives au sujet du « national », l’étranger a été désigné comme un facteur de d’altération voire de destruction de l’identité nationale et cet étranger a pris des figures différentes selon les époques : l’Italien, le Polonais, l’Oriental, les populations originaires d’Asie et d’Afrique, souvent avec les mêmes arguments et les mêmes stéréotypes Voilà encore un élément de débat actuel en France à travers la question des « mémoires » !
Troisième point qui est constitutif du phénomène : en effet, les identités nationales sont des « lieux de mémoire » comme le rappelle Pierre Nora, ce qui renvoie à l’ipséité. La « valeur identitaire » de la nation fait d’elle un « lieu de la mémoire collective et de la continuité historique ». Mais cette mémoire collective est « un cadre plus qu’un contenu, un enjeu toujours disponible, un ensemble de stratégies, un être-là qui vaut moins par ce qu’il est que par ce que l’on en fait » (introduction au tome 1 de l’ouvrage « Les lieux de mémoire ». Quarto Gallimard). En effet, la compétition existe dans le domaine politique entre des conceptions différentes de l’identité nationale comme nous le développerons plus loin. Mais cette mémoire nationale peut être aussi plurielle car les acteurs de la vie nationale, notamment sur le plan politique, ne mobilisent pas toujours les mêmes éléments de l’identité nationale ou ne les hiérarchisent pas de la même façon ; d’aucuns valorisent le sacre des rois à Reims ou leur sépulture à Saint-Denis, d’autres les « grands hommes » de la Patrie au Panthéon, d’autres le Mur des Fédérés au Père-Lachaise, ou d’autres leur identité régionale, etc. La mémoire historique est aussi un combat idéologique, un enjeu de reconnaissance et de vérité historique ! Pour certains, c’est toute l’histoire de France qu’il faut prendre en compte, comme une sorte de collections de faits, de personnages, d’histoires, sans tempo particulier, un continuum des origines (mais lesquelles pour la France ?) à nos jours, en multipliant les références intégrées dans l’identité, même si l’histoire a montré qu’elles furent très contradictoires ; pour d’autres la Révolution de 1789 et l’affirmation progressive, à travers combats et engagements, de l’identité républicaine et démocratique, au cours des deux derniers siècles, sont des ruptures historiques majeures et des moments essentiels dans la conception et la construction de l’identité nationale française. De plus, les identités mémorielles au sein de la nation peuvent être diverses (identités régionales, identités des groupes intégrés dans la nation par la colonisation ou venant des ex-colonies, minorités linguistiques revendiquant un statut officiel pour leur langue vernaculaire), car la mémoire des groupes sélectionne les éléments du passé pour construire leurs stratégies du présent afin d’affirmer leur présence dans l’espace public, de revendiquer une histoire différente reconnue dans cet espace ou la reconnaissance d’un passé douloureux, etc.. Voir la discussion sur les « lois mémorielles » (dans l’ouvrage : « La guerre des mémoires » et dans P. Weil : « Liberté, égalité, discrimination. L’ « identité nationale » au regard de l’histoire »).
B- Est-il alors possible de définir l’identité nationale ou, tout au moins de la cerner ?
Il est difficile de définir la notion parce qu’elle relève souvent de l’ordre du construit politique et de critères sélectifs selon les orientations philosophiques ou idéologiques qui sous-tendent la vision politique, parce qu’elle est relativement flexible selon les époques et les courants de pensée, et parce qu’elle est un enjeu conflictuel entre ceux qui la définissent. Mais les sciences sociales ont tenté de cerner le contenu de cette identité, en mettant en valeur des éléments qui se voudraient « objectifs », au-delà de toute polémique politique ; nous mobiliserons la démarche de Tzvetan Todorov (chapitre 2 : « Les identités collectives » dans « La peur des barbares ») qui précise que l’identité nationale recouvre plusieurs domaines qu’il faut distinguer pour savoir ce qui est en question dans le débat :
l’appartenance culturelle (à une culture nationale) qui crée une communauté
d’attitudes, un style de vie, façonne les comportements et produit des œuvres dans divers domaines, et à l’intérieur de laquelle les individus construisent leur propre identité (outre la langue, les modes de vie, un rapport à l’espace particulier, les créations artistiques, esthétiques, littéraires, les œuvres matérielles…) ; mais la culture nationale est elle-même en transformation et à l’intérieur de cette culture nationale dont on hérite sans y être pour quelque chose, il y a et il y a toujours eu une diversité culturelle plus ou moins grande ; depuis les années 1860, le travail d’intégration au sein de la nation a consisté à unifier les instruments de communication, comme la langue, condition de la « communauté de citoyens », à développer une instruction publique commune… Or, cette culture n’est pas une entité dotée d’une substance intemporelle, une totalité organique, aux frontières imperméables ; elle est constamment « travaillée, façonnée, recomposée par d’incessants processus d’emprunts et d’échanges » (l’acculturation est un mécanisme d’interactions entre les cultures). Historiquement, les cultures ne vivent que dans l’échange entre elles, c’est un enseignement fondamental de la sociologie et, notamment, de l’anthropologie. Vouloir fonder une identité sur une culture primordiale qui n’existe pas et qui n’a jamais existé est un leurre mais pas seulement, elle est une opération idéologique pour légitimer parfois un discours sur la « pureté » des origines de certains groupes ou individus face à l’Autre qui est différent et cela peut produire des ravages (cf. les épurations ethniques). Mais chaque culture, la française, l’allemande, l’américaine, la chinoise, possède une certaine configuration propre qui permet de l’identifier et de la distinguer de ses voisines, ce qui apparaît nettement dans les contacts entre individus La culture participera activement à la consolidation de la nation et a été mobilisée dans la construction de l’identité nationale dont fait partie le « sentiment national ». Pour le politologue Jean-François Bayart (dans « L’illusion identitaire ». Fayard. 1996) le mouvement « d’invention de la tradition » dont parle aussi l’historien britannique Eric Hobsbawm, et « qui a marqué l’histoire de l’Occident depuis la fin du XVIIIème siècle » est un « processus de formalisation et de ritualisation » qui « s’est traduit par l’inculcation, par voie de répétition, de certaines valeurs et de certaines normes de comportement se référant explicitement au passé, celui-ci pouvant être éventuellement reconstruit ou fabriqué ». Aussi, comme le souligne J.F. Bayart, la caractéristique majeure de l’ « invention de la tradition » est d’avoir été un moyen de l’innovation politique : éduquer les jeunes Français, quelles que soient leurs origines, à la citoyenneté et à la fidélité à la nouvelle République, en s’appuyant sur une tradition historique de la nation construite ou réinterprétée à cette fin. Et les préparer à la revanche sur l’Allemagne aussi comme cela a pu se réaliser avec l’Union Sacrée en 1914. Une tradition désigne « une pratique ou un savoir hérité du passé, répété de génération en génération ». Or souvent, elles sont récentes et ont connu des modifications. La tradition « comporte une part d’illusion entretenue à des fins symboliques et normatives » pour un groupe particulier (« La culture : de l’universel au particulier ». Ed. Sciences Humaines. page 218). On mobilise sélectivement la tradition pour construire l’identité nationale ; aussi, un auteur a écrit que la tradition est « un morceau du passé taillé à la mesure du présent » (idem).
l’identité civique qui s’exprime par une appartenance civique et administrative : être citoyen, sujet de droits et de devoirs, être sous l’administration d’un Etat à l’intérieur d’un territoire ; la citoyenneté nationale est le lien politique au sein de la nation et l’affaiblissement ou le délitement de ce lien participent à la « crise » de l’identité nationale car elle affecte le « faire société » (ou le « vivre ensemble ») au sein d’une société démocratique et diminue la force de la légitimité politique des gouvernants élus. Mais, d’un autre côté, s’expriment d’autres modalités de la citoyenneté à travers les formes multiples du militantisme civique (altermondialisme, appel à une citoyenneté détaché de sa base nationale, progression de la citoyenneté européenne, conscience écologique planétaire…). Un idéal politique et moral : une identité fondée sur l’attachement à des
valeurs morales ou éthiques et politiques telles que les valeurs de dignité, égalité, liberté, solidarité et fraternité, de refus des discriminations, d’universalité de la condition de citoyen, de liberté absolue de conscience… et à des principes de vie en commun et d’organisation institutionnelle qui les incarnent dans la vie sociale : laïcité, solidarité sociale, services publics, politique de réduction des inégalités, de démocratisation de l’Ecole, etc. Il ne s’agit pas toujours de valeurs spécifiquement françaises car certaines d’entre elles sont portées par la philosophie des droits de l’homme prônée par d’autres pays, par l’Union Européenne et par la Déclaration Universelle de 1948.
Cet idéal fonde un projet, toujours en chantier, compte tenu des défis internes et externes auxquels doit faire face le pays, celui de « faire société », car le lien politique est au cœur de la conception républicaine de l’intégration des individus membre de la nation en une « communauté de citoyens ». En termes sociologiques (D. Schnapper dans « La communauté des citoyens »), la nation moderne est un « processus d’intégration DE la société par le politique » jamais achevé (ou « intégration systémique ») et « d’intégration A la société déjà constituée » (ou « intégration tropique »), comme avec les populations des territoires constituant la France dans l’œuvre éducative et politique de la IIIème République ou avec les populations issues d’autres pays – dans ce dernier cas, ce phénomène accentue la diversité culturelle à l’intérieur du pays.
Il est donc difficile de subsumer ces trois dimensions dans une seule définition.
Comme nous l’avons vu dans la définition du mot « identité », le rapport à l’Altérité est au cœur de la définition et de la compréhension de l’identité nationale, un rapport qui est à la fois externe (la figure de l’étranger –individu, groupe, nation) et interne (les multiples figures des autres à l’intérieur de la nation – dans leurs identités régionales, religieuses, linguistiques, de territoires, de classes… comme nous le montrerons à propos de la production identitaire sous la IIIème République). Est-elle « un mode d’être » (Français » ou « Allemand » ou « autre ») qui caractériserait tous les membres d’une nation, auquel ils s’identifieraient et qui serait activé par la croyance en un « noyau de valeurs stables » (Françoise Dufour dans « Immigration et identité nationale. Une altérité revisitée ».L’Harmattan) ? Le « Même » de l’identité nationale risque de renvoyer à une figure abstraite ou floue compte tenu, de nos jours, de la richesse et de la complexité des identifications des individus conçue comme une « toile de significations » (pour Max Weber), mais il possède une valeur mobilisatrice et passionnelle dans l’ordre du politique par ses références à un « imaginaire national » plus ou moins fantasmé (la nation, l’unité, les filiations historiques, les grands évènements, les grands ancêtres, le patrimoine,…).
Enfin, l’identité nationale, comme toute identité collective (Dictionnaire de la sociologie. Larousse), comprend plusieurs fonctions :
elle exprime l’aptitude d’une collectivité à se reconnaître comme nation,
non seulement comme une collectivité « en-soi » mais « pour-soi » ; elle est le produit d’un mouvement de différenciation et d’affirmation à l’œuvre sur le long terme, plus ou moins récent selon les nations, et plus ou moins profond ; « le « nous » collectif se pose en s’opposant aux autres » (D. Schnapper), car ce mouvement s’opère toujours dans le rapport à l’Autre (les collectivités infranationales, l’étranger, les autres nations) à travers des processus d’emprunt, de rejet, de conflits, d’autonomisation, d’émancipation … Norbert Elias évoquait « le désir affectif de la société humaine » et la « tonalité émotionnelle de l’identité du nous » ; avec le risque, comme l’ont montré les exacerbations nationalistes, d’absolutiser les différences entre « Nous » et « Eux » et de déboucher sur un narcissisme national identitaire qui peut amener la valorisation excessive des traits nationaux et la dévalorisation des autres cultures, des stéréotypes xénophobes, des idées racistes, l’idée d’une supériorité de la nation ou de son rôle d’exemple et de guide pour les autres nations ; et, dans les périodes fortement conflictuelles comme la dislocation des entités politiques –cf. les Balkans – provoquer des violences intercommunautaires (« purification ethnique ») ; on concentre sur la Cité politique ou la culture l’identification affective à une communauté et on dévalorise les autres à l’égard desquelles on exprime des sentiments de rejet, de crainte, de mépris ou de haine ; ce fut le cas à l’égard des Juifs et cela l’est parfois à l’égard des populations d’origine étrangère. A l’extrême de la conception de l’identité nationale, la « pureté » de l’identité (un fantasme) et le refus de la diversité réelle de la nation, sont des instruments d’exclusion symbolique de la citoyenneté universelle, la source de lois restrictives, quand ce n’est pas celle de violences physiques dont l’histoire contemporaine est riche… Les identités nationales manipulées et érigées au rang de dogme suprême peuvent être meurtrières. Cette « identification passionnelle » va au-delà du sentiment national et l’identité nationale fait fusionner en elle les identités particulières qui lui sont subordonnées. Cela renvoie à l’image duale de la nation, comme l’a écrit Pierre Nora (dans « Guide républicain », page 68) : une « image positive » (la nation est liée à l’idée de civilisation, de progrès, d’émancipation des peuples opprimés et de souveraineté) et une « image négative » (le nationalisme xénophobe ou le patriotisme chauvin).
Pour Condorcet si l’amour de la patrie accompagne le sentiment d’appartenance au collectif national, il ne possède qu’une « valeur identificatrice limitée » (dixit Coutel : « Politique de Condorcet » page 234) car l’horizon c’est l’Europe qui est la « médiation entre la patrie et l’humanité » : « l’Europe devient un tribunal de la raison » et « l’opinion publique européenne est une instance qui ouvre la citoyenneté à l’universel » ; « l’amour de l’humanité » est inséparable de « l’amour de la République » ; il est conscient que l’exacerbation du sentiment national conduit à des dérives nationalistes et bellicistes dont l’antidote sont cet amour de l’humanité, l’instruction publique et les droits de l’homme. Pour Condorcet, les droits de l’homme, piliers de la République, sont « l’échelle commune à laquelle tout serait comparé, par laquelle tout serait mesuré » ; ils sont au cœur de l’identité démocratique de la France affirmée, sans être achevée, en 1789 (développement dans la seconde partie).
elle traduit un « principe de cohésion » de la collectivité nationale intériorisé
plus ou moins fortement, en chacun de ses membres ; pour Sophie Duchesne, « l’identité nationale est la façon dont, à un moment donné, les citoyens d’un pays conçoivent ce qui les unit », plus dans certaines périodes de l’histoire que dans d’autres ; ainsi, « l’identité nationale doit être comprise comme un compromis, daté, plus ou moins consensuel, résultant des conceptions concurrentes de la communauté politique, de ce qu’est un citoyen, dans un pays donné » ; aussi, existe une relation étroite et forte entre la politique et l’identité nationale. Pour F. Braudel « toute identité nationale implique, forcément, une certaine unité nationale, elle en est comme le reflet, la transposition, la condition » (Introduction à « L’identité de la France ». Histoire et mémoire. page 17).
elle fournit des « représentations » qui tendent à légitimer l’emploi du
« Nous » malgré la multiplicité des appartenances individuelles ou la vigueur des stratifications sociales ; elle fournit ainsi un « imaginaire national » (des images, des symboles, des idées, des valeurs….) qui active la conscience d’appartenance ;
elle est, en langage sociologique, une « ressource » mobilisée par les acteurs
du jeu politique à l’occasion de grandes ruptures politiques (comme la période de l’occupation allemande) ou dans le cadre de leur stratégie de pouvoir souvent à forte connotation idéologique, notamment en mobilisant le capital symbolique et la dimension affective et passionnelle que l’identité nationale contient et qui ne sont pas politiquement neutres ; l’identité nationale est donc un enjeu de pouvoir parce qu’à travers elle se posent des questions telles que celles du lien social, de l’intégration sociale, des relations de pouvoir et aussi de domination idéologique. Le projet politique, issu des valeurs et des principes proclamés par et incarnés dans la Révolution, a toujours été au cœur de l’identité nationale de la France (D. Schnapper) et de son identité démocratique (Vincent Duclert), mais la définition de ce projet a donné et donne encore lieu à des constructions et à des filiations différentes voire divergentes (comme sous la IIIème République), ou parfois à un relatif consensus (comme le programme issu de la Résistance). Le débat actuel le démontre encore clairement.
C- Peut-on donner un contenu précis à l’ « identité française » hors de toute polémique politique ?
Dans une approche sociologique, un auteur qui a beaucoup apporté à la réflexion et à l’analyse sur la « Nation en tant que communauté de citoyens » et sur « La relation à l’Autre » Dominique Schnapper, sociologue et membre actuel du Conseil Constitutionnel, rappelle que la nation demeure une « dimension privilégiée de l’identité collective où s’exprime la continuité de la mémoire historique ; elle reste aussi, au moins pour l’instant, le lieu de l’expression et des pratiques démocratiques ». Dans sa réponse à la question « Existe-t-il une identité française ? » (dans « L’identité ». Sciences Humaines)- elle évoque, à propos de l’identité nationale, la matrice suivante qui permet de repérer, sans trop détailler, les domaines définis par T. Todorov ; nous la donnons à titre d’illustration :
la mémoire historique qui fonde le sentiment national et qui fait que cette
identité surgit à la « conscience claire quand elle se confronte à d’autres identités ». Mais aussi de rappeler que même lorsque le patriotisme républicain dominait l’opinion, les identités particulières (régionales et linguistiques – bretonne, corse, basque- ou autres – juive,
arménienne, russe, polonaise) n’ont pas été effacées. Être français, c’est partager les souvenirs glorieux des combats de la nation mais aussi les mêmes pages sombres (régime de Vichy, répressions coloniales) ;
un rapport particulier à la langue qui forge un même mode d’expression mais
aussi une même vision du monde et développe un art de la discussion et de l’argumentation ;
au-delà de la culture savante ou « culture cultivée » (Edward Sapir), l’identité
nationale s’exprime chaque jour par un style de vie particulier (le fameux « french art de vivre »), comme on peut le voir à travers les relations entre individus (façons de s’aborder, de se parler, distance, rapport à l’autorité, modes de sociabilité, etc) ;
dans un autre domaine, le style des rapports politiques porte l’empreinte de
l’identité nationale ou l’exprime pleinement, notamment en France, où la passion de l’universel, de l’idéal de justice, d’égalité et de liberté, de l’affirmation des droits de l’homme et de la citoyenneté, ont été des vecteurs du combat démocratique et républicain (cf. l’introduction à l’ouvrage « Dictionnaire critique de la République ») ; le principe de la citoyenneté dans la démocratie britannique est née de la volonté de protéger les libertés en créant des contre-pouvoirs émanant de la représentation politique des principales forces sociales ; en France, au contraire, l’idée de la citoyenneté individuelle issue de la Révolution de 1789 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août de la même année, et le principe de la laïcité fondent le « modèle républicain » qui affirme l’égalité civile et politique de tous les citoyens, sans distinction d’origines et de convictions spirituelles, et fait de l’espace public un espace non religieux.
Pour Pierre Nora (tome 1 page 578) le rapprochement de tant d’objets « apparemment si éclatés qui constituent l’identité et la mémoire nationale et confère à leur réunion son homogénéité et son appartenance à une même gamme de phénomènes, on le trouverait dans leur commune manière de mettre en évidence une dimension du politique dont on est en train de découvrir qu’elle constitue peut-être sa vérité dernière : sa dimension symbolique ».
2- L’idée de la nation moderne et ses rapports avec l’identité nationale en France.
Après avoir explicité ce que signifie la nation et les débats fondateurs à ce sujet, nous montrerons qu’elle a fait l’objet d’un récit très particulier par le pouvoir politique et dans l’Ecole, puis nous nous pencherons sur l’identité démocratique de la France que d’aucuns préfèrent à la notion d’identité nationale, pour terminer sur les rapports entre identité nationale et immigration, et identité nationale et Europe.
A- La nation et le discours sur la nation en France.
Pour Pierre Nora, dans le « feu de la Révolution », se sont fondus et fixés les trois sens du mot « nation » : le sens social (« une population vivant sous les mêmes lois, réunies sur un même territoire et appartenant à la même nationalité »), le sens juridique (« un corps de citoyens égaux devant la loi et personnifié par une autorité souveraine » émanant de ce corps), le sens historique : « une collectivité unie par le sentiment de sa continuité, un passé partagé, un avenir commun, un héritage culturel à transmettre » – ici, l’identité nationale française.
La nation moderne, déjà pensée par les auteurs du XVIIIème siècle, est un sujet collectif qui associe deux principes : un principe politique, qui est abstrait et universel – celui de l’identité politique, d’une communauté de citoyens reconnus comme tels et non en fonction de leurs appartenances particulières ; ici, nous pourrions parler de « valeurs républicaines » qui anime la citoyenneté politique (tolérance, laïcité, démocratie, liberté, égalité, solidarité) ; et un principe culturel, plus concret, celui de l’identité culturelle, celui de l’appartenance liée à une communauté de langue, de mode de vie, d’organisation sociale, de religion, etc. ; ici, nous pourrions parler de « valeurs françaises » à l’échelle nationale. Si le politique et le culturel peuvent être séparés, tout en étant en relation, dans la relation à l’Autre à l’intérieur de la nation, cela permet de distinguer deux processus sur lesquels le « Haut Conseil à l’Intégration » met l’accent : l’intégration doit être celle du « politique » par le biais de la citoyenneté universelle (c’est la condition de l’existence d’un espace public civique) et l’assimilation qui implique que des individus appartenant à des cultures différenciées au sein de la culture nationale (régionales, étrangères) transforment leur propre identité en assimilant des éléments de la culture nationale commune à tous (processus complexes décrits par la sociologie de la culture avec les études sur l’acculturation). Une des questions qui se pose : jusqu’à quel point les identités culturelles particulières sont-elles compatibles avec l’identité politique ? On trouve, aujourd’hui, cette interrogation avec la question de la compatibilité de certaines prescriptions de l’Islam et de l’identité républicaine et démocratique (problèmes du statut de la femme, de la séparation du théologique et du politique, poids des prescriptions religieuses dans l’espace public – affaires du foulard, du voile intégral).
A propos du mode d’exposition de l’histoire nationale dans les manuels scolaires de la IIIème République comme celui, célèbre, d’Ernest Lavisse, dont l’influence a perduré jusqu’aux années 1960 (Lavisse est qualifié d’ « instituteur national »), les historiens appellent aujourd’hui ce récit un « roman national » ou « récit national » qui forge une représentation de l’identité nationale et qui exprime un rapport du politique à l’histoire de la nation ; pour N. Offenstadt, il s’agit :
d’un « récit patriotique, unitaire, qui insiste sur une histoire longue et cohérente de la France» ; on se souvient de la fameuse expression « Nos ancêtres les Gaulois » qui établit une filiation mythique ; ce fut quasiment une approche « théologique » de l’histoire de France (la « religion » de la France) et une approche téléologique (une fin est inscrite en elle qui était la formation unitaire de la nation française triomphante avec la Révolution) ; on peut parler même d’une « prédestination » (S. Citron) comme si l’histoire de la nation était jalonnée d’étapes orientées dans un sens défini ou immanent – elle devait s’accomplir ainsi ; « qui met en avant les hauts faits, les héros et édulcore souvent les pages les plus délicates » : les héros guerriers et les bons rois face aux méchants (les souverains étrangers, les envahisseurs) y occupent une place importante car ils ont servi la France, ce que l’on demande aux jeunes Français, notamment l’idée du sacrifice pour la patrie ; on néglige les aspects négatifs de l’histoire (les massacres, les conquêtes brutales) parce qu’ils ne correspondent à l’image positive de la nation que l’on veut inculquer à ces jeunes, pour former l’unité spirituelle de la nation ; et on y insiste sur la mission civilisatrice de la France, « patrie de l’universel » (pour Michelet) ; et d’ « un récit qui « naturalise » le patriotisme depuis les temps anciens » ; alors que le sentiment d’appartenance à une « nation » n’était que le fait d’une élite éduquée et souvent ouverte sur l’Europe et que la France n’était qu’un composé de petites « nations » peu liées entre elles et aux particularités culturelles très marquées (Bretagne, Provence, Midi toulousain, Dauphiné, Picardie, Ile de France…), à la manière des « pommes de terre dans un sac » pour reprendre une image de Marx à propos de la paysannerie française au XIXème siècle ou pour reprendre la formule de Mirabeau, à la veille de la Révolution, « une agrégation inconstituée de peuples désunis » ; sans nier l’œuvre d’unification et de centralisation et de construction de la nation menée par la monarchie avant 1789.
Ainsi l’historiographie sous la IIIème République fit d’une certaine représentation de l’histoire de France une composante majeure de la construction de l’identité nationale républicaine dans une époque d’affrontements très marqués sur la conception de la nation, de son passé et de son projet unificateur. Elle a construit consciemment les caractères de la « francité ». L’affirmation identitaire de la nation française a mobilisé des filiations évolutives au fur et à mesure de l’élaboration de l’espace politique national et de son imaginaire. Suzanne Citron a montré que l’ « histoire de France » est le fruit de reconstructions successives, parfois loin de la réalité historique, qui vont donner sens et cohérence à l’idée de nation et à son devenir. « La nation commence toujours par une historiographie qui confine au mythe » (Dictionnaire de la sociologie. Larousse, article « nation »). Avant la Révolution, des « abrégés d’histoire de France » convoquaient, en guise de mémoire historique, les faits et gestes des trois dynasties des rois de France, en commençant par Clovis, puis suivaient Charlemagne et Hugues Capet. Aux XVème-XVIème siècles, le mythe de l’origine troyenne des rois est bousculé par la découverte des Gaulois évoqués par les auteurs romains, Gaulois associés par certains auteurs aux origines de l’humanité après le Déluge. Au XVIIIème siècle, éclate la querelle idéologique entre les partisans des Francs, ancêtres de la noblesse (privilégiée par droit de conquête) et les partisans des Gaulois, peuple vaincu, au nom du tiers état. L’abbé Sieyès (dans « Qu’est-ce que le tiers état ? ») invite les nobles à retourner dans « les forêts de Franconie ». La Révolution marque le triomphe des Gaulois sur les Francs. En 1828, un historien (Amédée Thierry) publie une histoire des Gaulois qui permettent d’ « ethniciser » la nation en suggérant la filiation des Français avec ces Gaulois. Dans les débuts de la IIIème République, Vercingétorix devient le héros initial d’une longue succession de défenseurs de la « nation », parmi lesquels Jeanne d’Arc occupe une place de choix dans la rhétorique républicaine enseignée aux jeunes Français (cf. les livres d’histoire de Lavisse). Un livre très célèbre « Le tour de France de deux enfants » de G. Bruno (alias Mme Fouillée, épouse d’un des idéologues de la troisième République), distribué à plus de 7 millions d’exemplaires dans les écoles de 1877 à 1914, , avec en sous-titre : « Devoir et Patrie », dans la préface, commence par la phrase suivante : « La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique » ; et se termine ainsi : « En groupant ainsi toutes les connaissances morales et civiques autour de l’idée de la France (c’est nous qui soulignons), nous avons voulu présenter aux enfants la patrie sous ses traits les plus nobles, et la leur montrer grande par l’honneur, par le travail, par le respect profond du devoir et de la justice ». Or, ce procédé de narration a été repris dans la campagne des élections présidentielles de 2007, avec le « tour de France » des villes du candidat élu, en mobilisant les grandes figures locales qui ont marqué l’histoire de la France et en redéfinissant un récit national qui s’appuie à la fois sur le brouillage des références historiques, leur syncrétisme (de multiples figures et évènements sont évoqués, même les plus contradictoires : Barrès, Jaurès, par exemple), leur décontextualisaton (on ne retient que ce qui est légitime aux yeux du bâtisseur de cette histoire), sur le brouillage des clivages politiques (on casse les filiations dira le conseiller du Président pour qui l’historien doit seulement mettre en valeur les faits historiques) par l’appropriation des figures de l’autre camp – Jaurès, Blum, Guy Mocquet par exemple, et où l’on réconcilie les adversaires d’hier. La conflictualité entre les démarches politiques, au cœur des définitions de l’identité nationale, depuis 1870, est ainsi évacuée.
Rappelons, comme le disait Paul Ricœur, que l’identité nationale est aussi une « identité narrative » ; elle raconte une histoire souvent imaginaire, car la nation est, rappelons-le, au-delà de valeurs communes partagées une « communauté politique imaginaire et imaginée » (selon l’expression de Benedict Anderson).
B- Un éclairage sur les grandes polémiques avant 1914.
Faisons un détour par des auteurs du XIXème siècle : Jules Michelet, Fustel de Coulanges et Ernest Renan, puis évoquons le débat entre Maurice Barrès et Jean Jaurès au début du XXème siècle. Pourquoi ? Parce que certains de ces protagonistes sont toujours mentionnés dans le débat actuel, et parce que leurs réflexions permettent de comprendre non seulement les idées politiques de l’époque où émerge cette question de l’identité nationale, mais aussi celles du temps présent et la permanence de la thématique de l’identité nationale et ses principales orientations.
( Jules Michelet (1798-1874) a une vision progressiste de la nation et de l’identité nationale, sous l’influence des idéaux de la Révolution française ; dans la définition républicaine de la nation, à la citoyenneté il ajoute la dimension de l’identité. Michelet considère la France comme « une personne » qui aurait pris conscience d’elle-même en 1789 car la Révolution a répandu les idéaux des Lumières de Paris vers les peuples des provinces qu’on appelait les « nationalités » et qui vont se fondre dans la nationalité française. Aussi, la nation française, comme le souligne Braudel dans le texte cité plus haut, ne peut perdurer qu’en se révolutionnant sans cesse. L’identité nationale repose ainsi sur « la lutte des contraires qui est le moteur du progrès » (G. Noiriel) : cette lutte est un processus menée par les forces de progrès contre le déterminisme de la « nature » et de la « race » qui a entraîné l’intégration des « nationalités » (peuples des régions) dans la nation française et le triomphe de l’universel sur les particularismes. C’est sa conception évolutionniste de l’identité nationale qui ne fait pas de celle-ci une identité figée et qui fait de la France la « patrie de l’universel ». Par ailleurs, pour Michelet, l’énergie des classes populaires est le « ferment de l’identité nationale » (G. Noiriel) par leur comportement révolutionnaire et leurs luttes politiques. Pour Michelet, l’identité nationale est dynamique, tournée vers l’avenir. La France-Messie et la légende républicaine se trouvent chez Michelet et inspirera toute l’historiographie de la IIIème République (cf. Suzanne Citron : « Le mythe national. L’histoire de France revisitée »).
( La guerre de 1870 marque un tournant dans la problématique de l’identité nationale partout en Europe et, en France, s’élabore une conception « républicaine-conservatrice »
de l’identité nationale (G. Noiriel).
Fustel de Coulanges, avant Renan, dans une polémique avec un auteur allemand, en 1870, et intitulé « Réponse à Mommsen à la question : « L’Alsace est-elle allemande ou française ? », opposait le principe des nationalités au principe du nationalisme ; Mommsen justifiait la politique d’annexion de Bismarck par la « germanité ethnique, linguistique et culturelle de l’Alsace » (D. Schnapper), quelle que fût la volonté des Alsaciens ; tandis que Fustel de Coulanges soutenait que l’Alsace était « française par la nationalité et le sentiment de la patrie ». L’identité nationale est une construction et elle est une incarnation : « ce qui distingue les Nations, ce n’est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, de souvenirs, d’affections, d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns après les autres, la patrie c’est ce qu’on aime ».
Ernest Renan qui est très souvent cité dans le débat actuel et qui n’adhéra au courant républicain qu’après la guerre de 1870 (célèbre conférence du 11 mars 1882) posait la question « Qu’est-ce qu’une nation ? ». La nation est à la fois un héritage, matériel et symbolique et un contrat. Pour lui, comme l’explique le philosophe Jean-Marc Ferry (dans la revue « Comprendre. Les identités culturelles ». P.U.F. n° 1. 2000), l’appartenance à la nation se fonde sur une « référence au passé » (« la possession en commun d’un riche legs de souvenir »), sur une « référence au présent » (le « consentement actuel ») et sur une « référence à l’avenir projeté » (« le désir de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis »). L’énoncé que la nation est « une âme, un principe spirituel » insiste donc sur le passé : cette dimension que l’on peut qualifier de « conservatrice » sera sur-valorisée par les nationalistes à la fin du XIXème siècle (cf. Maurice Barrès) ; mais Renan avance un autre principe, inscrit dans le présent, « le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis », une espèce de contrat qui lie les citoyens d’une nation moderne : et ajoute-t-il « une nation suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune ». Toutefois, cet auteur délaisse complètement l’apport des populations étrangères à la formation de l’identité nationale. On pourrait dire qu’une nation, c’est le « génie national » plus le contrat (comme le mentionne B. Kriegel).Avec ce « patriotisme historique », le sentiment national a culminé en Europe et s’est réalisée « l’unité de la communauté morale et de la communauté légale dans une communauté politique reposant sur le libre consentement de ses membres » (J.M. Ferry), c’est-à-dire la nation. Ernest Renan ne voyait pas en la nation la forme définitive de l’identité politique et culturelle ; pour lui, les nations ne sont pas éternelles et, écrivait-il, « sans doute la grande confédération européenne, un jour, les remplacera » (nous discuterons de la question de l’identité européenne de nos jours). Renan ne niait pas la détermination culturelle de la nation en affirmant qu’elle est « un principe spirituel résultant des complications profondes de l’histoire, une famille spirituelle » et qu’elle repose sur une tradition et un héritage culturel ; il conteste que « cette tradition, cette âme du peuple soit tout entière et seulement contenue dans la dynastie, la race, la langue, la religion, l’économie, la géographie, l’effort militaire, comme le romantisme politique a essayé de l’accréditer » (Blandine Kriegel : « Philosophie de la République ». Plon. 1998). Pour lui, la nation ne peut venir d’une unité ethnique parce « qu’il n’y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une chimère »
Renan a formulé une distinction, au sujet de la définition de la nation, dans le contexte des affrontements des nationalismes et des Etats de la seconde moitié du XIXème siècle, distinction que le langage moderne opère entre la « nation ethnique » (le Volk allemand) et la « nation civique » (la nation politique française). La « nation civique » est envisagée comme une « libre association politique des citoyens, une construction rationnelle et volontariste. Cette nation contractuelle, élective, civique, c’est la « nation à la française », conceptualisée par les Lumières et réalisée par la Grande Révolution » (A. Dieckhoff) ; pour Sieyès et Renan, la « détermination fondamentale de cette association c’est l’adhésion libre et volontaire, la seule limite que puisse connaître la nation. Parce qu’il y a adhésion volontaire et libre, la nation s’ouvre à un horizon indéterminé. On n’en naît pas membre. On le devient sur la base de la volonté manifeste de se conformer aux principes de l’association. On peut également cesser d’en être membre si l’on veut, la nation, devient alors ce qu’elle veut être, ce que ses membres manifestent la volonté d’être » (« Dictionnaire de philosophie politique » sous la direction de Philippe Raynaud et Stéphane Rials. PUF-Quadrige). Aussi Renan a-t-il écrit : « l’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours ».
A cette conception moderne de la nation qui culmine dans le projet révolutionnaire de
1789 et la conception de Jules Michelet , s’oppose l’idée romantique de la nation telle que l’incarne la conception de la nation allemande : elle est une « nation ethnique », une « concrétisation d’une communauté culturelle, l’expression d’un sentiment identitaire, le reflet d’un ordre naturel ; cette identité nationale « est presque close, située et repliée sur elle-même, par des liens organiques, naturels, c’est-à-dire historiquement advenus dans une communauté vivante de personnes unies par la même langue et les mêmes origines, donc une communauté qui avant tout manifeste nécessairement sa différence » (citation du « Dictionnaire de philosophie politique » page 479). Chez certains auteurs allemands du XIXème siècle, cette idée d’une nation authentique par l’unité de sa langue, la pureté du sang et des mœurs et par l’attachement du groupe à ces éléments prendra l’allure d’une « réelle obsession », notamment pour définir l’essence de la nation, son identité. Johan Gottfried Herder réagit contre l’importation des valeurs des Lumières françaises auxquelles il reproche leur universalisme abstrait négateur de l’identité culturelle qui est unique pour chaque nation – égale en dignité à toutes les autres pour Herder.
Cette opposition est « historique et idéologique » comment le rappellent D. Schnapper, A. Dieckhoff et G. Noiriel : elle est née autour de la question de l’Alsace-Lorraine, suite à son annexion par l’Allemagne après la défaite française de 1870 : pour les historiens allemands, l’incorporation des Alsaciens dans le Reich se justifiait par le fait de leur culture allemande, tandis que Renan et Fustel de Coulanges défendaient le droit des Alsaciens à rester français si tel était leur choix politique. Il en a dérivé pendant longtemps l’opposition, souvent plus théorique que réelle, entre deux types de nationalité : le « jus soli » ou droit du sol dans la tradition républicaine française et le « jus sanguinis » de type ethnique et culturel dans la tradition allemande (pour une étude approfondie du droit de la nationalité, voir Patrick
Weil : « Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution »).
Cette antinomie entre la « nation civique » et la « nation ethnique » a eu beaucoup d’échos et continue à en avoir chez certains auteurs : « au nationalisme politique né dans le sillage de la Révolution française, autour d’un Etat ancien et puissant » « rassemblement de citoyens libres et égaux » « répondrait un nationalisme organique, nourri par la langue et l’histoire, qui a prospéré dans des pays dépourvus d’Etat (Italie, Pologne, pays du Tiers-monde) » soit une « communauté d’origine unie par un héritage culturel partagé » (A. Dieckhoff, pages 64-65). Cette approche binaire est critiquée à la fois pour des raisons théoriques et idéologiques (des penseurs allemands, comme Herder, ont aussi insisté sur le lien politique et civique au fondement de la nation), et pour des raisons politiques liées à l’histoire : lors du « Printemps des peuples » et l’éveil du « principe des nationalités », lors des révolutions de 1848 à l’est de l’Europe ; la révolution hongroise de 1848, avec la participation active des plus grands poètes hongrois (Petöfi notamment), a été précédée par une littérature écrite en langue hongroise (et non en latin ou en allemand), mais a exprimé un fort registre politique : le programme élaboré par le libéral Kossuth s’appuie sur le triptyque français « Liberté, égalité, fraternité » et réclame la pleine souveraineté politique de la nation hongroise (assemblée nationale, libertés publiques). Dominique Schnapper explique que la nation n’est pas purement « civique » ou purement « ethnique » ; toute nation démocratique est à la fois « ethnique » et « civique » (dans « L’idée républicaine aujourd’hui. Guide républicain ». Delagrave. 2004) : elle comprend simultanément des éléments dits « ethniques » (une culture, une langue, une histoire propre et commune à ses membres, une conscience collective, celle de partager ces références, et une mémoire collective et historique singulière) et un principe civique qui fait que les individus sont aussi des citoyens par-delà leurs différences culturelles, sociales et religieuses, malgré leurs inégalités de fait mais non de droit, et c’est le « principe de l’universalité » ou de l’universalisme républicain.. Les deux types d’éléments permettent de « faire société ». [De plus, avec le nazisme et les conséquences de la seconde guerre mondiale, s’est posée à nouveau la question de l’identité nationale allemande. Un auteur réputé comme Jürgen Habermas a proposé l’expression de « patriotisme constitutionnel » qui « signifie entre autres la fierté que nous avons réussi à triompher de façon durable du fascisme pour établir l’ordre d’un Etat de droit », car la démocratie n’a pu s’établir qu’après Auschwitz ; l’identification à une constitution démocratique et à ses valeurs constituerait, pour Habermas, la voie de l’identité nationale allemande de nos jours, dans le cadre d’une société pluri-ethnique ; mais ceci est fortement discuté outre-Rhin.]
( Pour le débat sur l’identité nationale en France, évoquons l’opposition entre Maurice Barrès et Jean Jaurès qui différencie « nationalisme » et « progressisme » car elle permet d’insérer le débat actuel dans la longue durée et de montrer que les thématiques des acteurs politiques peuvent être souvent des « remakes » du passé repensés dans la conjoncture politique et idéologique du moment : un « passé présentifié » dirait Anne-Marie Thiesse (dans « Cahiers français ». n° 342). On peut dire qu’il s’agit d’un affrontement droite-gauche sur la définition de l’identité nationale. L’approche de Barrès est « nationaliste » (sans sens polémique car lui-même se définissait comme tel) et exprime une version conservatrice de l’identité nationale en insistant sur le thème de « la terre et des morts », défendu une partie de la droite républicaine jusqu’à la seconde guerre mondiale. Pour Barrès, pour constituer une nation et pour forger la « conscience nationale », il faut « des cimetières et un enseignement d’histoire » (comme le précise Marcel Detienne, page 23). Il accuse l’industrialisation, l’immigration, les villes et les étrangers (aux élections de 1893, Barrès fait campagne sur le thème « A bas les étrangers ») accusés de porter atteinte à l’identité française ; l’affaire Dreyfus le poussera à approfondir son analyse, tout en basculant vers le nationalisme : il valorise la religion catholique comme source de permanence et de continuité historique en France, il fait référence à la France paysanne dans la recherche des racines de l’identité française. Il affirme que « le mort tient le vif » ; il disait que « pour permettre à la conscience d’un pays tel que la France de se dégager, il faut raciner les individus dans la terre et dans les morts », c’est-à-dire, ajoutait-il « que les précédents historiques et les conditions géographiques sont deux réalités qui règlent la conscience nationale » (dans « La Terre et les Morts ». 1899) – revoir la citation de Thomas Payne, complètement antinomique, page 10 ; ainsi, le passé détermine le présent par un sorte de déterminisme absolu – Renan disait qu’il fallait « réchauffer les cadavres refroidis » – ; et il défend donc l’Eglise, l’armée, l’Académie française, il exalte la terre française et le monde rural… Pour Barrès, la « haine du voisin » est « un puissant élément du sentiment national » (G. Noiriel) : « tout étranger, installé sur notre territoire, alors même qu’il croit nous chérir, hait naturellement la France éternelle, notre tradition ». Aussi, l’identité nationale se définit contre l’étranger qu’il prenne la figure du travailleur immigré, du Juif, de l’Allemand. Barrès attaque Jean Jaurès qui, en défendant le principe de la lutte des classes, affaiblit le consensus national, porte atteinte à l’identité nationale et favorise l’ennemi. Charles Maurras (et l’Action Française) et Charles de Bonald, placeront l’identité française dans une approche xénophobe et antisémite ; Emmanuel Todd écrit que, pour Maurras, « le peuple français n’est plus l’expression première de l’homme universel [comme dans la pensée républicaine], mais un type spécifique qui doit défendre son essence contre les agressions du monde extérieur, contre l’étranger polluant incarné sur la sol national par quatre types : le Juif, le Métèque, le Franc-Maçon et le Protestant ». L’approche de Jean Jaurès se situe aussi dans le contexte de « politisation de l’identité nationale » à la fin du XIXème siècle et de l’affirmation politique du mouvement ouvrier syndical et politique. Jaurès place sa réflexion sur l’identité nationale dans la continuité du mouvement du « Printemps des peuples » qui a soulevé l’Europe au milieu du XIXème siècle et s’inscrit dans une perspective « patriotique » (au sens où l’on entendait à cette époque avant que ce qualificatif ne devienne l’apanage des droites nationalistes). Pour lui, la question nationale n’est pas centrale, c’est la question sociale qui l’est ; il plaide pour une révolution par des voies pacifiques, mais, simultanément, il défend, face au discours identitaire nationaliste de Barrès, les idéaux laïques de la République. Il accorde une importance centrale à l’éducation qui doit former des citoyens pour échapper aux déterminismes des traditions et aux dogmes religieux qui fixent l’identité nationale pour Barrès. Avec la reprise de l’antagonisme franco-allemand, Jaurès cherche à concilier défense de l’intérêt national et les idéaux universalistes de paix du mouvement ouvrier, et il appelle « patriotisme » ce « discours de gauche » sur l’identité nationale. En résumé, l’identité nationale est appréhendée de deux points de vue politiques : l’approche héritée de Barrès qui est le « nationalisme » (« elle relève d’une logique sécuritaire qui vise à défendre l’identité nationale contre la « menace » que fait peser sur elle ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur ») et l’approche héritée de Michelet et de Jaurès appelée « patriotisme » révolutionnaire (qui « consiste à être fier de faire partie d’un pays qui contribue aux progrès de l’humanité tout entière » – citations de G. Noiriel).
( Pour cet historien, on assiste à une bi-polarisation radicalisée par l’affaire Dreyfus : d’un côté, la « droite nationale-sécuritaire et antidreyfusarde » qui défend la propriété, la sécurité, les traditions françaises et la religion catholique – soutenue par les classes aisées et une partie de la petite bourgeoisie et de la paysannerie, de l’autre, la « gauche social-humanitaire », soutenue par les ouvriers et les fonctionnaires, qui milite pour les droits de l’homme, la laïcité et le développement de la protection sociale. C’est le parti radical dominant jusqu’en 1939 qui va imposer la « nouvelle définition » de l’identité nationale triomphante au début du XXème siècle et qui réalise un compromis entre droite et gauche. C’est donc la IIIème République qui a véritablement construit, fabriqué la « communauté nationale » et l’identité nationale qui est devenue une dimension de l’identité citoyenne, dans le contexte d’affirmation de l’identité de classe des ouvriers et de leurs luttes sociales. L’Etat-nation, en tant qu’organisation politique, triomphe à la fin du XIXème siècle ; s’intensifie et se systématise alors « l’œuvre de construction identitaire » (A.M. Thiesse, page 237) : la « nationalisation de l’Etat » qui devient un « instituteur du social » passe un travail approfondi et soutenu d’éducation au national. En France, l’Etat a précédé et a créé la nation. Dans d’autres pays, au contraire, c’est la nation qui a suscité l’Etat (la nation allemande a longtemps existé sans expression étatique).Mais parallèlement, la construction de l’identité nationale française sous la République s’est accomplie en refoulant les « identités particulières », notamment régionales, avec leur langue et leur folklore, refoulement qui a été une des conditions de la formation de la citoyenneté universelle et individuelle. L’intégration nationale, en France, « ne reconnaît pas les communautés particulières dans l’espace public et fonde sa légitimité sur le principe de la citoyenneté individuelle » (D. Schnapper : « La relation à l’Autre. Au cœur de la pensée sociologique »). La dé-liaison des rapports opérée par la Révolution entre les individus et les groupements collectifs (cf. l’abolition des corporations par la loi Le Chapelier en 1791), le substrat anthropologique de l’individualisme égalitaire de la Déclaration de 1789, la suppression des corps intermédiaires qui limitent la liberté individuelle et sont en concurrence avec le projet identitaire national, l’affirmation du centralisme politique au détriment des collectivités régionales, l’unification culturelle par la langue et l’Instruction publique, ont eu pour buts et pour effets de « fonder le peuple français un et uni, composé d’individus égaux en droits », d’établir la nation en tant qu’être collectif, et de développer le « sentiment d’une communauté d’appartenance » à la nation qui transcende voire occulte et relègue au second rang les autres appartenances dont on se méfiait (influence du clergé notamment).
Ces rapports de refoulement et de sujétion des identités particulières (linguistiques, locales, religieuses, ethniques) envers l’identité nationale a donc été l’œuvre de l’Etat en France ; toutefois la distinction entre espace public – lieu d’unité de tous les citoyens sans distinction d’origines et de croyances- et espace privé de la vie – lieu de la liberté des individus qui peuvent développer des pratiques propres- permet de voir que les identités spécifiques n’ont pas été interdites mais seulement cantonnées dans la sphère de la vie privée qu’elle soit individuelle ou associative ; les immigrés, par exemple, ont toujours pu exprimer leurs particularismes dans la vie associative et religieuse, parfois avec le soutien des autorités publiques qui y ont vu un moyen de réduire les effets négatifs provoqués par le contact avec une culture et une société différentes de celles d’origine et de faciliter l’intégration. La langue est une composante centrale de l’identité nationale ; la généralisation et l’imposition du français comme langue de la nation civique et des échanges culturels et économiques, était prônée par l’abbé Grégoire qui avait conduit une enquête, en 1792, intitulée : « rapport sur la nécessité d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française » et par Barère pour qui « la langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous » ; cette énorme régression des langues locales servait plusieurs objectifs : fonder un sentiment national d’appartenance commune – à la nation française-, unifier le corps politique dans une citoyenneté unique, propager les valeurs de la Révolution, puis celles de la République, rompre les allégeances locales issues de l’Ancien Régime, faciliter la mobilité des travailleurs dans l’espace économique national.. Aussi, l’éducation au national, soit la politique scolaire de la IIIème République avec Jules Ferry, a été le vecteur de la diffusion de la langue unitaire de la citoyenneté, même si localement les « hussards noirs de la République » et les notables républicains ont su composer avec les langues vernaculaires souvent vues comme les supports de l’anti-modernité et du cléricalisme. On estime qu’en 1880, près de la moitié de la population française apprenait le français à l’école comme une langue étrangère. Comme l’exprime Alain Dieckhoff, l’Etat a été un « acteur culturel très entreprenant » ; outre la langue unique des institutions de la République, l’éducation ou, selon le langage du XIXème, l’Instruction publique, fut le grand œuvre de la construction de l’identité nationale, dans la lignée de la Révolution de 1789 et visait au partage d’une culture commune tout en formant les futurs citoyens ; il s’agissait, là aussi, d’ « instituer la nation par un intense travail culturel », « instituer » dans la double acception : « fonder » et « enseigner » d’où l’emploi du mot « instituteur ». Les hommes politiques de la IIIème République ont trouvé chez Condorcet l’importance du rôle attaché à l’ « Instruction publique », même si Jules Ferry et l’enseignement de cette période ne se situent pas tout à fait dans l’idéal condorcétien car Ferry est plus un « positiviste » inspiré de la science du progrès d’Auguste Comte qu’un continuateur de Condorcet, homme des Lumières et de la raison critique, hostile à une imposition idéologique étatique (cf. le livre de Pierre Kahn : « Condorcet. L’école de la raison ».Hachette-Education. 2001).
B- L’identité démocratique de la France.
Ici, « interroger l’identité française », c’est aussi lire dans l’histoire de la pensée politique, dans les discours des hommes politiques et dans les dispositions législatives et constitutionnelles, donc y lire le « projet démocratique » toujours en mouvement et l’idéal républicain de liberté et de justice, souvent malmené par l’histoire mais toujours fixé comme un idéal. La matière est très riche en ce domaine. Nous en évoquerons quelques dimensions.
Nous sommes là dans deux registres évoqués dans l’approche de T. Todorov : l’identité politique et civique traduite en dispositions institutionnelles et l’identité appréhendée comme un idéal politique et moral. C’est ici que nous sommes dans le domaine le plus polémique avec des lectures plurielles de l’histoire et de l’appropriation des références historiques, avec des combats politiques nombreux et parfois hautement symboliques (affaire Dreyfus, séparation des Eglises et de l’Etat en 1905, défense de la République en 1934, la Résistance, dénonciation de la torture en Algérie, par exemple). La lecture des contributions au débat sur l’identité nationale sur le site du « Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement » est pleinement révélatrice de cette discussion.
Cette identité démocratique (et républicaine – mais des conflits ont aussi surgi entre la démocratie et des pratiques au sein de la République) s’est construite au cours des siècles comme « doctrine positive de liberté », et s’est affirmée contre le culte identitaire de la nation, au nom des valeurs politiques de liberté, de tolérance et de justice, comme l’exprime l’historien Vincent Duclert (« La France. Une identité démocratique. Les textes fondateurs ». Seuil. 2008). Il est réticent à utiliser l’expression d’ « identité nationale » parce qu’elle renvoie au « culte du national », à la « raison d’Etat » et à « l’extrême droite » et parce que l’histoire de la France montre que l’on s’est souvent fourvoyée dans le nationalisme, la violence légale et la xénophobie et le racisme à l’égard des étrangers. Il emploie de façon privilégiée l’expression « identité démocratique ».
Reprenons quelques axes majeurs du travail de cet historien :
face à une « vision exclusiviste, autoritaire et nationaliste » de l’identité nationale, l’identité démocratique de la France élaborée par le droit et par la pensée ne s’est pas forgée contre la nation, mais contre « la tyrannie du national », en définissant la nation comme une « société ouverte fondée sur des valeurs politiques communes » et par un « corpus de libertés et de droits non contradictoires à la nation, mais qui l’encadrent et la limitent ». Ce corpus a un texte fondateur : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui définit les droits de la personne et du citoyen comme « hautement politiques et constitutionnels » (préambule des constitutions de 1791,de 1946 et de 1958) ; elle fut précédée par d’autres textes majeurs tels que l’Habeas Corpus (1679) et le Bill of Rights (1689) anglais, la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis (4 juillet 1776) et les Dix premiers amendements à la Constitution américaine (1791) qui confèrent à ces droits et libertés démocratiques une véritable force constitutionnelle. Elle a été suivie par la Déclaration Universelle de 1949 et par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés de 1950.
Pour Condorcet, la Déclaration de 1789 est une « école de vigilance pour tous les citoyens » (Charles Coutel, « Politique de Condorcet ». page 171) ; rappelons qu’il propose « de rapporter aux droits de l’homme toutes les dispositions des lois, toutes les opérations administratives, tous les moyens comme tous les principes » ; et « la déclaration des droits serait l’échelle commune à laquelle tout serait comparé, tout serait mesuré » (dans « Cinq mémoires sur l’instruction publique » de 1791) ; Marcel Gauchet dit que les « droits de l’homme sont une politique et, plus, l’âme et l’ancre de toute politique » .
comme l’écrivait Claude Lefort (1991), les droits de l’homme sont un des principes générateurs de la démocratie et l’essence du totalitarisme est de les récuser ; leur efficacité vient de l’adhésion qui leur est apportée. Aussi, les droits ne se séparent pas de la conscience des droits d’autant mieux partagée quand ils sont déclarés, qu’ils sont garantis par le pouvoir, et qu’ils sont visibles dans des lois.
V. Duclert ajoute que « la capacité de la France à conserver un idéal et des pratiques démocratiques résida fortement dans le pouvoir des droits de l’homme et dans leur usage militant individuel et collectif » dans toute l’histoire de la France depuis la Révolution ;
Pour lui, « la fragilité actuelle de l’identité démocratique française explique bien des aspects de la crise d’identité que traverse le pays (…). Plus les Français s’illusionnent dans le culte de la nation, plus ils s’enfoncent dans le malaise, conscients (…) qu’ils s’éloignent de quelque chose d’essentiel et qui les mènera à la protestation solennelle le moment venu ».
Cette identité démocratique est véritablement un projet politique parce que son contenu n’est jamais définitif mais qu’il s’enrichit de la revendication, de la conquête et de l’institutionnalisation des droits civils et politiques au XIXème et au XXème siècles (droits-libertés – Dominique Schnapper : liberté syndicale, liberté d’association, liberté de la presse, grands lois sur l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire, loi de séparation des Eglises et de l’Etat, abolition de la peine de mort, droit de vote des femmes, etc.) et des droits économiques et sociaux au XXème siècle (droits-créances : les diverses lois sur la durée du travail, les congés payés, les accidents du travail, l’assurance-chômage, revenu minimum, sécurité sociale, etc.). Ce « patrimoine commun de droits et de libertés » est constitutif de l’identité démocratique de la France.
3- L’identité nationale au miroir d’autres identités.
Deux thèmes, d’une grande portée politique, nous semblent importants, et qui soulèvent de nombreux questionnements dans la société française : l’identité nationale et l’immigration, l’identité nationale et l’Europe.
A- L’identité nationale et l’immigration.
L’établissement de liens entre les deux phénomènes pose une série de questions, très
souvent « sensibles » (c’est un euphémisme !), souvent obscurcies par des voiles idéologiques et des préjugés, sur les rapports entre le « Même » et l’ « Autre », lourdes de sens sur la gestion de l’identité nationale par le pouvoir politique, mais aussi riches d’enseignements sur l’histoire et la société françaises. Vous savez que la polémique est très forte à ce sujet avec la création du Ministère associant ces termes. Il n’est pas besoin de rappeler les arguments et les critiques concernant cette initiative, partisans et opposants les ayant largement multipliés et développés à travers les médias. L’extrême sensibilité de ce thème a rapport avec les dérives du passé de l’histoire de France (violences, xénophobie, racisme d’Etat sous Vichy). Mais peut-être l’association de ces deux termes fait-elle aussi partie de ces voiles qui empêchent d’apprécier clairement et pleinement les mécanismes d’intégration ou d’assimilation en œuvre depuis les années 1870, appréciables seulement sur la longue durée, et obscurcissent le lent travail de « l’intégration silencieuse et réussie » (Henri Mendras dans « Français, comme vous avez changé ». L’Aube. Poche Essai. 2007), par la référence à des problèmes réels, mais surmédiatisés, des cités et des banlieues (de la délinquance, de l’échec scolaire, de la présence du fondamentalisme religieux radical, de la ghettoïsation ethnique, etc.).
L’historien Pierre Milza souligne que « la grande erreur est de vouloir comparer un phénomène très récent (intégration, difficultés d’intégration ou non-intégration des populations maghrébines et africaines) avec des processus réalisés il y a très longtemps ». La durée du contact dans la société d’accueil joue un rôle important. Historiquement, l’assimilation (ou l’intégration) n’a jamais été facile, mais elle s’accomplissait à travers des instances affaiblies de nos jours : l’emploi industriel, l’école, les partis, les syndicats, le service militaire, les églises, les associations (ces dernières ont joué un rôle essentiel dans ce processus en amortissant les chocs du contact culturel et en maintenant des pratiques de la culture d’origine : langue, fêtes, traditions religieuses…). Un des vecteurs de la « crise d’identité », liée aux problèmes actuels, serait que l’intégration s’accomplit plus difficilement dans un contexte de ségrégation urbaine, de chômage massif, de pauvreté, de permanence des discriminations de fait (non légales), d’anomie pour une partie de la jeunesse concernée qui, d’ailleurs, possède la nationalité française. Le sociologue Michel Wieviorka fait remarquer que « les groupes qui fonctionnent le plus sur un mode communautaire » (Asiatiques, Portugais, et aussi les Turcs) sont peu ou moins présents dans le débat public, à l’inverse des groupes issus du monde arabo-musulman et d’Afrique noire qui suscitent « beaucoup d’interrogations et de fantasmes », d’autant plus que s’exprime, qu’on le veuille ou non, un processus de « refoulé du colonial », à travers stéréotypes et discriminations xénophobes quand ce n’est pas racistes. Des dispositifs ont été mis en place pour lutter contre ce phénomène (lois, création de la Halde). La question soulevée par les historiens, les politologues, les sociologues et les démographes, spécialistes de cette question est : « S’intégrer, oui, mais à quoi ? » : à son propre milieu social, le plus immédiat (ici, le « monde des banlieues ») ? A sa classe sociale ? A l’espace politique et à la citoyenneté ? Adhésion aux valeurs fondatrices du modèle républicain ? Au monde de l’emploi ? A celui de la consommation ? A la culture médiatique ? A l’Ecole et aux études ? En matière de mariages dits « mixtes » ? De comportements de fécondité ? Comment évolue la pratique religieuse ? Quel usage de la langue d’origine et du français ? Quels sont les outils pour appréhender et mesurer cette intégration ? Disons, pour simplifier, que malgré les tensions, les difficultés, les discriminations, l’intégration s’accomplit, de façon non linéaire comme dans les décennies d’avant 1940. Entre la culture dominante, celle de la société d’accueil, et la culture des immigrés, s’établissent des rapports d’interaction complexes qui sont le plus souvent de l’influence de la première sur la seconde, et contribuent à sa transformation, ce que l’on désigne sous les noms d’assimilation ou d’intégration (emprunt, sélectivité, réinterprétation, rejet, syncrétisme). C’est plus l’identité culturelle des migrants qui est affectée que l’identité nationale, et il faudrait expliquer dans quels domaines et par quels mécanismes, celle des migrants est affectée. De nombreux travaux existent à ce sujet, loin d’une certaine vulgate partisane. On oublie souvent l’hétérogénéité au sein de la population immigrée, relativement forte (origines, religions, catégories sociales) et l’on n’évoque pratiquement pas le cas des immigrés de l’Union Européenne au sein desquels la diversité est importante aussi.
L’apport des populations étrangères fait partie intégrante de la société française et de son héritage historique, depuis le milieu du XIXème siècle (connaissance par les premiers recensements de la population étrangère).A la différence des autres pays européens, la France a été un pays d’immigration pour des raisons démographiques et économiques (que l’on pourra expliciter dans la discussion). L’intégration des immigrés est une question centrale des débats politiques en France depuis les années 1880. C’est à cette époque que se développe une « nationalisation » de la société (expression de Gérard Noiriel) et que s’opère le clivage entre Français et étrangers par le code de la nationalité de 1889 (1889 : première loi sur la nationalité et la naturalisation pour savoir qui est Français et qui est étranger notamment en vue de la conscription obligatoire – qui pouvait être soldat ou pour bénéficier de la priorité dans l’emploi). Pendant longtemps, l’immigration fut un « non-lieu de mémoire » en France (G. Noiriel) et un phénomène peu étudié, même si dans la vie politique la figure de « l’Autre » fut largement mobilisée comme miroir de l’identité dite française et comme exaltation du « national ». Le postulat du caractère « inassimilable » de certaines catégories d’immigrés exprime l’idée qu’il existe, chez les étrangers non-européens, ou du moins chez certains d’entre eux, une « part d’altérité irréductible et incompatible » avec la culture nationale (Julien Bach). Ce serait une stigmatisation de l’origine qui n’est pas nouvelle dans le regard que l’on porte sur l’Autre. Ce faisant, on passe outre à la distinction fondamentale du pacte républicain que nous avons déjà abordée : la distinction entre « espace public » (de la citoyenneté universelle et égalitaire) et « espace privé » (où s’expriment la diversité et les particularités culturelles, religieuses, sociales, spirituelles, et qui relèvent des choix individuels et de la liberté de chacun, sous réserve de respect des lois fondant l’égale dignité de chacun, sa liberté, et l’absence de contravention aux lois civiles). Dans ce cadre, le philosophe Alain Renaut a pointé (tribune du journal « Le Monde » du 7 novembre 2009) le risque que « l’identité nationale se communautarise à son tour », en privilégiant l’identité autour de la communauté de culture des Français, « présentée comme lestée de valeurs irréductibles à celles de toute autre communauté » au détriment de l’identité comme appartenance à la nation civique (« réunie autour de principes politiques et juridiques »). Et il formule cette approche critique : « dans ce cas, une forme de communautarisme guette le nationalisme républicain, parce que la fidélité à l’identité nationale en vient à prendre le pas sur le respect des droits et des devoirs impliqués par l’appartenance à l’humanité comme telle ». Aurions-nous du mal à assumer une diversité culturelle croissante, un multiculturalisme de fait ? C’est un élément de débat qui mérite discussion. Les indicateurs montrent que l’intégration culturelle s’accomplit, souvent par une double appartenance – culture d’origine dans la famille, culture française à l’école et dans d’autres espaces non scolaires- et que le métissage progresse dans la société française, notamment avec les mariages mixtes. D’autre part, pour les enfants d’immigrés algériens, devenus adultes, la convergence est réelle avec les caractéristiques moyennes de la société française, encore plus à statut social équivalent : taux de fécondité, pratique religieuse, réussite scolaire. Les immigrés et leurs enfants inventent aussi des identités plus complexes, notamment les jeunes femmes, au carrefour de plusieurs influences, comme chez les autres Français d’ailleurs et comme l’ont fait, historiquement, les Italiens, les Polonais, etc., établis en France. Ce qui, soit dit en passant, est bien dans la lignée du « système de valeurs individualistes égalitaire » qui « donne son orientation universaliste à la France » (Emmanuel Todd : « Le destin des immigrés ». Seuil. L’histoire immédiate. 1994).
Un politologue, Pierre Birnbaum (dans un ouvrage « La France imaginée. Déclin des rêves unitaires) a analysé les conséquences du « repli généralisé de l’Etat » et la montée du pluralisme culturel dans notre société qui s’exprime par la diversification des identités qu’il appelle des « identités rivales » : identités régionales, religieuses, mouvements homosexuels, constitution d’associations qui réclament la réévaluation critique de la mémoire historique française – comme le Conseil des associations noires-, etc. ; il pose la question de la fin du « monolithisme » de l’identité nationale française et de la présence de ces identités particulières qui, dit-il, « demeurent ouvertes, aptes à s’installer dans l’espace public, dans prétendre se constituer en « nations de nation ». Rivales les unes des autres, elles accentuent la dimension ouverte et pluraliste de la société française débarrassée des visions homogénéisatrices contraires. Partielles et dépourvues de prétentions conquérantes, elles n’ont pas vocation, ni les unes ni les autres, à réimaginer autrement la France ».Il s’agit d’ « identités minces » – Michaël Walzer- qui sont « limitées dans leur portée et fidèles à une idée d’universalité de l’homme, à une « morale
minimale » commune, une « reconnaissance mutuelle », demeurant compatibles entre elles au sein d’un espace public même républicain » – à la différence des « identités épaisses » qui « enferment l’acteur dans une culture collective communautaire incompatible avec le modèle » républicain à la française et les valeurs portées par la laïcité – c’est-à-dire le « communautarisme » de fait, à défaut d’être de droit. Cette analyse permet aussi de mieux situer les cultures et les identités des populations d’origine étrangères dans la société française qui s’apparentent plutôt au premier type, sauf pour une minorité. Les enquêtes comparatives en Europe montrent que les populations d’origine musulmane vivant en France expriment une adhésion très largement majoritaire aux valeurs de la République et à la laïcité.
La complexité de la question, l’extrême sensibilité du sujet, comme sa politisation très forte, amènent à soulever des problèmes importants pour la société française (intégration, inégalités multiples, respect des droits de l’homme dans toutes leurs dimensions), mais aussi à se méfier des amalgames abusifs et des slogans dévastateurs dans l’opinion quand bien même la gestion de ces problèmes est parfois difficile, mais doit l’être faite en s’inspirant des valeurs et des principes qui fondent l’identité démocratique de la France. C’est la tâche ardue mais nécessaire des partis politiques républicains.
B- L’identité nationale et l’Europe.
La question de l’identité nationale dans ses rapports avec l’Europe et celle de l’émergence d’une identité européenne, avec le processus de l’intégration européenne depuis plus d’un demi-siècle, ne sont pas, semble-t-il, aussi fréquemment évoquées dans le débat actuel que la question précédente. Et, pourtant, l’Europe est de plus en plus notre horizon politique, juridique, économique et culturel. Elle est une construction originale fondée sur le droit et la négociation, et non sur la conquête et la force, ce qui fait d’elle un facteur de paix, rompant avec les divisions et les affrontements séculaires sur le continent.
Nous voudrions souligner quelques points dans ce domaine.
La France s’est toujours caractérisée par un Etat fort et unitaire, centralisé, avec des compétences d’intervention étendues dans l’économie et la société. Or, la construction européenne entraîne, inévitablement, sans entrer dans les détails, un transfert de compétences vers cet échelon supranational de décision et un affaiblissement du rôle et de la souveraineté de l’Etat-nation, ce qui peut créer un malaise identitaire au sujet du devenir du « modèle français ».
En matière politique, l’Europe crée de nouvelles formes de gouvernance, assez complexes comme on peut le voir en ce moment. Se pose pour la citoyenneté un enjeu d’importance. La nation politique a été et est encore largement le lieu privilégié du fonctionnement démocratique et la « communauté des citoyens » reste pour l’essentiel une communauté nationale. Qu’en est-il d’une communauté européenne de citoyens ? Qu’en est-il d’une identité démocratique européenne ? Peut-elle être comme certains l’ont formulée une citoyenneté post-nationale dépassant le fait national ?
On trouve deux types de position (bien révélées notamment dans la campagne pour la ratification du projet de traité constitutionnel en 2005) : d’une côté, les partisans du maintien d’un lien politique national fort, c’est-à-dire d’une relation étroite entre la nation et la démocratie ; de l’autre, les partisans du dépassement du fait national, favorables à une démocratie européenne plus élargie et plus approfondie. Mais pour que cette seconde option se réalise pleinement, il faudra du temps et une volonté politique commune, celle des peuples et des gouvernants. La construction d’un domaine politique européen pleinement développé, transcendant les espaces politiques nationaux, suppose plusieurs conditions :
que l’Europe ne soit pas seulement un espace de civilisation, une « mêmeté »,
fondée sur des caractéristiques communes produites par l’histoire et la culture, mais qu’elle possède un véritable espace public européen, avec ses règles, ses institutions, ses « enjeux compris et acceptés par tous » (D. Schnapper), sa culture politique commune, et avec une société civile européenne agissante et consistante, afin que les citoyens européens aient véritablement le sentiment de participer aux choix de l’Europe, à ses débats, à la désignation des gouvernants comme dans le cadre national ; qu’elle soit un véritable « corps politique » (Pierre Manent) fondé sur le principe démocratique du consentement ; or, dans ce domaine, la question du « territoire » de l’Europe n’est toujours pas résolue… que les Européens adhèrent à un socle de valeurs communes qui sont celles de la démocratie et de l’Etat de droit et qu’elles se traduisent en pratiques politiques ; ces dispositifs institutionnels existent en Europe et sont un puissant facteur d’unification et un cadre essentiel pour l’adhésion des nouveaux membres ; qu’ils aient une conscience d’appartenance commune, d’adhésion à une histoire commune, voire à un imaginaire européen (c’est l’ipséité), tous éléments qui contribueraient à forger une « identité européenne », comme celle d’une « fraternité solidaire » (A.M. Thiesse) et d’une « communauté de destin ».
Ce sera une œuvre politique de longue haleine…
Et, terminons cette réflexion, par une citation de notre « bon Condorcet » comme l’appelait son amie Julie de Lespinasse et qui résonne avec des accents d’une grande actualité à nos oreilles : « le sentiment de l’amour de la patrie doit être employé pour combattre les effets de l’opposition entre l’intérêt individuel et celui de la société, comme la philanthropie pour arrêter les prétendus intérêts nationaux (…). C’est donc en donnant plus d’étendue à nos idées, en montrant nos intérêts sous un point de vue plus juste et plus général ; c’est en accoutumant les enfants à ne pas avoir besoin, pour plaindre et pour partager les douleurs d’autrui, d’en être les spectateurs ; de connaître, de savoir près de soi l’individu qui l’éprouve ; c’est en leur inspirant l’habitude de transformer ce sentiment individuel de la compassion en un sentiment général d’humanité, qu’on peut parvenir à rendre la philanthropie une affection vraiment universelle. C’est alors qu’on pourra l’opposer à l’intérêt mal entendu de la patrie qui conseillerait des injustices » (« Fragment de l’histoire de la Xème époque de l’Esquisse (1793) – cité dans « Politique de Condorcet » page 239).
Roger Le Fers, agrégé de l’Université, président du Cercle Condorcet des Alpes-Maritimes.
BIBLIOGRAPHIE
ABOU Sélim : « De l’identité et du sens. La mondialisation de l’angoisse identitaire et sa signification plurielle ». Perrin.2009.
AMSELLE Jean-Loup : « Vers un multiculturalisme français ». Champs-Flammarion. 1996.
ANDERSON Benedict : « L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme ». La Découverte-Poche. 2009.
BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, VERGES Françoise : « La République coloniale ». Pluriel-Hachette. Littératures. 2008.
BAYART Jean-François : « L’illusion identitaire ». Fayard. 1996.
BECKER Jean-Jacques et CANDAR Gilles (sous la direction de) : « Histoire des gauches en France ».
L’héritage du XIXème siècle. 2. XXème siècle : à l’épreuve de l’histoire. La Découverte/Poche. 2005.
BIRNBAUM Pierre : « La France imaginée. Déclin des rêves unitaires ? ». Folio-Histoire. 1998.
BLANCHARD Pascal et VEYRAT-MASSON Isabelle (sous la direction de) : « Les guerres de mémoires. La
France et son histoire ». La Découverte. 2008.
BRAUDEL Fernand : « L’identité de la France ». Arthaud-Flammarion (trois tomes). Champs-Flammarion. 2000.
« LES CAHIERS FRANÇAIS » : « L’identité nationale ». n° 342. Janvier-février 2008.
CALVET Louis-Jean et VERONIS Jean : « Les mots de Nicolas Sarkozy ». Seuil. 2008.
CITRON Suzanne : « Le mythe national. L’histoire de France revisitée ». Les Editions de l’Atelier.2008.
CONSTANT Fred : « Le multiculturalisme ». Dominos. Flammarion. 2000.
CONSTANTINI Dino : « Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité politique française ». La Découverte. 2008.
CORM Georges : « La question religieuse au XXIème siècle ». La Découverte-Poche. 2007.
COTTIAS Myriam : « La question noire. Histoire d’une construction coloniale ». Bayard. 2007.
« COURRIER INTERNATIONAL ». n° 993 du 12 au 18 novembre 2009.
COUTEL Charles : « Politique de Condorcet » (textes présentés par). Petite Bibliothèque Payot/Classique. 1996.
DE COCK Laurence, MADELINE Fanny, OFFENSTADT Nicolas, WAHNICH Sophie : « Comment Nicolas
Sarkozy écrit l’histoire de France ». Agone. 2008.
DE COCK Laurence et PICARD Emmanuelle : « La fabrique scolaire de l’histoire ». Agone. 2009.
DE SINGLY François : « Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien ». Pluriel. Hachette.2005.
DE SINGLY François : « l’individualisme est un humanisme ». Editions de l’Aube. Essai. 2005.
DETIENNE Marcel : « Où est le mystère de l’identité nationale ? ». Panama. 2008.
DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA REPUBLIQUE (sous la direction de Vincent DUCLERT et Christophe PROCHASSON). Flammarion. 2002. (nombreuses entrées).
DICTIONNAIRE DE PHILOSOPHIE POLITIQUE (sous la direction de Philippe REYNAUD et Stéphane RIALS). Quadrige. Presses Universitaires de France. 2003.
DIECKHOFF Alain : « La nation dans tous ses états. Les identités nationales en mouvement ». Champs-Flammarion. 2000.
DUCHENE Sophie : « Il ne faut pas refuser le débat sur l’identité nationale ». « Libération » du 12/13 mai 2007.
DUCLERT Vincent : « La France – une identité démocratique. Les textes fondateurs ». Seuil. 2008.
DUMONT Gérard-François et VERLUISE Pierre : « Géopolitique de l’Europe ». Partie I : « Identités et diversités en Europe ». Sedes. 2009.
ERBA Salvatore : « Une France pluriculturelle. Le débat sur l’intégration et les discriminations ». Librio. 2007.
FOUREST Caroline : « La dernière utopie. Menace sur l’universalisme ». Grasset. 2009.
GODELIER Maurice : « Communauté, société, culture. Trois clefs pour comprendre les identités en conflits ». CNRS Editions. 2009
GUIDE REPUBLICAIN – « L’idée républicaine aujourd’hui ». CNDP. MEN. Delagrave. 2004.
HORTEFEUX Brice : « Ma vision de l’identité nationale ». « Libération » du 27 juillet 2007.
KACI Rachid : « Comment peut-on être Français ? ». Larousse. A dire vrai. 2009.
KRIEGEL Blandine : « Philosophie de la République ». Plon. 1998.
« LE MONDE » du samedi 7 novembre 2009 : « Aux racines de l’identité nationale ».
« LIBÉRATION » du jeudi 19 novembre 2009 : « Cogiter l’identité nationale ».
MAILLOT Agnès : « Identité nationale et immigration. La liaison dangereuse ». Les Carnets de l’Info. 2008.
MANENT Pierre : « Cours familier de philosophie politique ». Tel Gallimard. 2004.
MEYRAN Régis : « Le mythe de l’identité nationale ». Berg International. 2009.
NOIRIEL Gérard : « A quoi sert l’identité « nationale » ? Agone. Septembre 2007.
NOIRIEL Gérard : « Population, immigration et identité nationale ». Hachette-Supérieur. Carré d’histoire. 1992.
NOIRIEL Gérard (rencontre avec) : « Les Français d’abord : une invention républicaine ». Revue Sciences Humaines. n° 144. Décembre 2003.
NOIRIEL Gérard : « Etat, nation et immigration ». Folio. Histoire. 137. 2005.
NORA Pierre (sous la direction de) : « Les lieux de mémoire ». Trois tomes. Gallimard. 1997 trois tomes. Gallimard. 1997.
OFFENSTADT Nicolas : « L’histoire Bling-bling. Le retour du roman national ». Stock. 2009.
OUVRAGE COLLECTIF « Identité(s) – L’individu, le groupe, la société ». Ed. Sciences Humaines. 2009.
OUVRAGE COLLECTIF « La culture – De l’universel au particulier ». Ed. Sciences Humaines. 2002.
OUVRAGE COLLECTIF : « Immigration et identité nationale. Une altérité revisitée ». L’Harmattan. 2009.
Dossiers Sciences Humaines et Sociales. Série Consommation et société.
RENAN Ernest : « Qu’est-ce que la nation ? » (1882). Ed. Mille et une nuits.
REVUE COMPRENDRE : « Les identités culturelles ». n° 1. 2000. PUF.
SARKOZY Nicolas : discours à la Chapelle-en-Vercors du 12 novembre 2009 sur l’identité nationale – sur le
site Internet de la Présidence de la République.
SCHNAPPER Dominique : « La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation ». Nrf-Essais. Gallimard. 1994.
SCHNAPPER Dominique : « La France de l’intégration. Nrf-Gallimard.1991.
SCHNAPPER Dominique : « La relation à l’autre. Au cœur de la pensée sociologique ».Nrf-Essais. Gallimard. 1998.
SIRINELLI Jean-François (sous la direction de) : « Histoire des droites en France ». 1. Politique. 2. Cultures. Tel Gallimard. 2006
THIESSE Anne-Marie : « La création des identités nationales. Europe XVIIIè-XXè siècle ». Points-Seuil. Histoire. 2001.
TODD Emmanuel : « Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les sociétés occidentales ». Seuil. L’histoire immédiate.1994.
TODOROV Tzvetan : « L’esprit des Lumières ». Robert Laffont. 2006.
TODOROV Tzvetan : « La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations ». Robert Laffont. 2008 (Chapitre 2. Les identités collectives. Chapitre 5 : L’identité européenne).
WALZER Michael : « Traité sur la tolérance ». Nrf Essais. Gallimard. 1998.
WEIL Patrick : « Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution ». Grasset. 2002.
WEIL Patrick : « La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations ». Seuil. La République des Idées. 2005.
WEIL Patrick : « Liberté, égalité, discriminations. L’ « identité nationale » au regard de l’histoire ». Grasset.2008.
WIEVIORKA Michel : « La différence ». Balland. 2001.